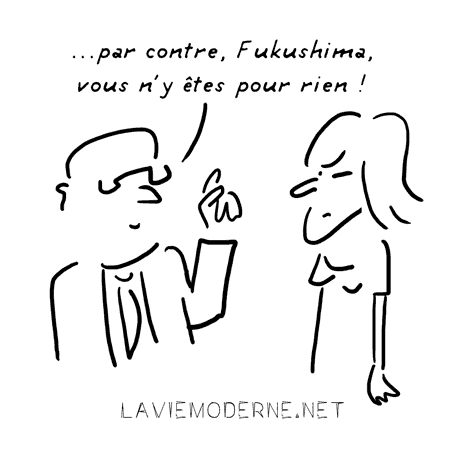« Gérer les enseignants autrement »
Le 22 mai 2013, la Cour des comptes a rendu public un rapport saignant : « Gérer les enseignants autrement ». Mais qui l'a vraiment lu ?
La presse a fait son miel de ses nombreuses recommandations iconoclastes, mais hélas sans guère lire le rapport lui-même ni porter sur elles un minimum d’esprit critique1.
À nous donc de lire ce rapport avec recul et minutie, de consulter les études et enquêtes auxquelles il se réfère et de percer à jour ce qui relève en lui du cliché ou du parti-pris, de l’irréalisme ou de la contradiction, du raccourci ou parfois même du mensonge par omission : ce rapport se caractérise en effet autant par ce qu’il dit que par ce qu’il ne dit pas.
Gardons cependant courage : cette patiente autopsie du rapport de la Cour des comptes, tout en prenant la défense de notre école républicaine, aura la vertu de trouver – dans un horizon scolaire bien morne – quelques raisons d'espérer.
Sommaire
Introduction : une thèse sommaire
1. Dépenses d’éducation : petits raccourcis et omissions.
L’évolution des dépenses d’éducation
Le montant des dépenses d’éducation
La démographie aux oubliettes
2. La gestion des enseignants en cause.
Les enseignants trop nombreux ?
Les enseignants trop chers ?
3. Le statut des enseignants en ligne de mire.
La « modulation » des obligations de service
Pour un régime « indemnitaire »
Les corps en fusion
La « polyvalence » comme horizon
La liberté pédagogique au rebut
L’évaluation au rabais.
4. Pour un recrutement moderne.
L’affectation, principe désuet
Le recrutement dans les établissements difficiles
L’exemple très pertinent… de l’enseignement privé.
5. Le petit miracle de l’annualisation.
Pour un emploi du temps flottant
Le gravissime problème de l’absentéisme des enseignants
6. De l’instruction publique à l’éducation territoriale.
La fin des concours nationaux
La territorialisation de la gestion des enseignants
L’obsession du « pilotage »
La rationalisation agressive de l’offre éducative.
7. Une forte coloration idéologique.
Toujours plus de “nouvelles pédagogies”
La réussite pour tous… mais quelle réussite ?
L’égalité des chances dévoyée.
8. Le mépris du métier d’enseigner.
Les préjugés au comptoir
La vocation d’enseignant, incompréhensible concept.
9. Les enseignants au rapport.
Une thèse sommaire
La Cour des comptes est « garante de la gestion efficace et du bon emploi des fonds publics », ce qui constitue bien sûr un dessein louable, en particulier dans les temps difficiles que nous traversons. Ses contrôles ont pour fonction d’évaluer l’efficience et l’économie (« les résultats constatés sont-ils proportionnés aux moyens mis en œuvre ? ») ainsi que l’efficacité (« les résultats constatés correspondent-ils aux objectifs poursuivis ? ») d’une politique.
Mais en vérité ce rapport de la Cour des comptes, ainsi que nous le verrons, ne prétend pas obéir à la seule raison économique et n’hésite pas pour cela à sortir de son champ de compétence.
La thèse du rapport est simple et se fonde sur deux postulats : 1) La dépense éducative en France est trop élevée pour des résultats médiocres. 2) Cette dépense excessive et ces résultats médiocres proviennent d’une mauvaise « gestion des enseignants ».
Nous montrerons que ni l’un ni par conséquent l’autre ne se vérifient.
Dépenses d’éducation : petits raccourcis et omissions
Curieusement, le rapport prend appui sur des comparaisons internationales (les enquêtes PISA 2009 au niveau seconde de 2000 à 2009 et PIRLS 2011 au niveau CM1) ainsi que sur les propres enquêtes de la Cour des comptes dans trois pays de l’OCDE (le Canada, l’Allemagne et les Pays-Bas), comme si la « gestion des enseignants » ou les « performances du système éducatif français » de la France ne pouvaient être évaluées par elles-mêmes. Comme si la comparaison de systèmes éducatifs si différents ne devait pas se faire sans de grandes précautions : prenons donc la Cour à son propre jeu et allons jusqu'au bout de ces trois comparaisons qu'elle a choisies.
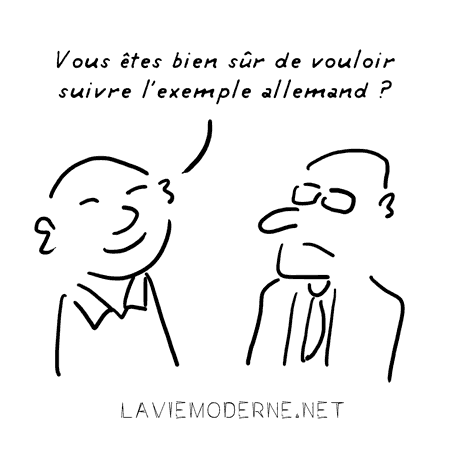
L’évolution des dépenses d’éducation
« Si les enquêtes internationales montrent la diminution continue des performances du système éducatif français depuis une décennie, les moyens financiers qui lui ont été alloués sur la période couverte par ces études ont, en revanche, connu une hausse constante alors que le nombre d’élèves décroissait. » (p. 11)
L’affirmation d’une telle « hausse » appelle plusieurs commentaires :
– Il est vrai que le nombre d’élèves dans les premier et second degrés a fléchi mais – tous niveaux et privé et public confondus (puisqu’il s’agit ici des dépenses d’éducation en général) – ce nombre est resté stable entre 2000 et 2009 (+0.11%) et a même augmenté de 1,44%2 entre 2000 et 2011.
– Cette « hausse constante des moyens financiers » s’explique mécaniquement par la part des pensions de retraite de plus en plus importante dans les dépenses d’éducation (voir plus bas), ainsi que le confirme le Ministère de l'Éducation nationale.
– Tous les pays de l’OCDE ont connu une telle augmentation, dans des proportions comparables, voire largement supérieures à la France. D’après la Banque mondiale3, entre 1998 et 2009, le montant des seules dépenses publiques d’éducation a augmenté de 84% en Allemagne, de 96% en France, de 118% au Canada et de 160% aux Pays-Bas.
– Cette « hausse des moyens financiers » est vraie en valeur absolue et elle est pour ainsi dire mécanique. Mais en valeur relative, si l’on observe la proportion de cette dépense par rapport au PIB ou mieux à l’ensemble des dépenses publiques, la France fait partie des rares pays dont les dépenses publiques d’éducation ont diminué entre 2000 et 2009, comme le démontrent les graphiques suivants :
Évolution des dépenses d’éducation en % du PIB entre 2000 et 2009
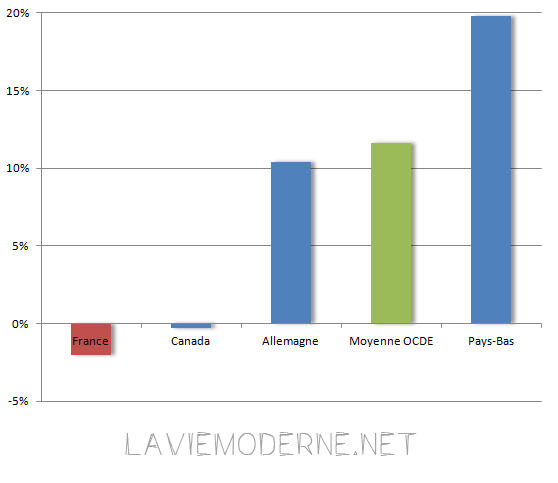 Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2012, tableau B4.3
Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2012, tableau B4.3
Évolution des dépenses d’éducation
en % du total des dépenses publiques entre 2000 et 2009
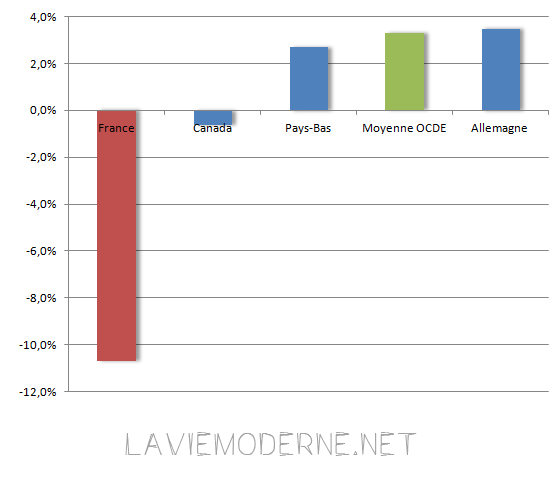 Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2012, tableau B4.3
Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2012, tableau B4.3
On peut constater, à partir du dernier graphique, que l’effort consenti en France par la nation pour l’éducation a diminué de plus de 10% en neuf ans, quand il est resté constant ou a augmenté dans les autres pays. Voilà une évolution relative sur laquelle la Cour des comptes garde pieusement le silence, continuant à évoquer « la priorité financière » accordée au système éducatif (p. 135).
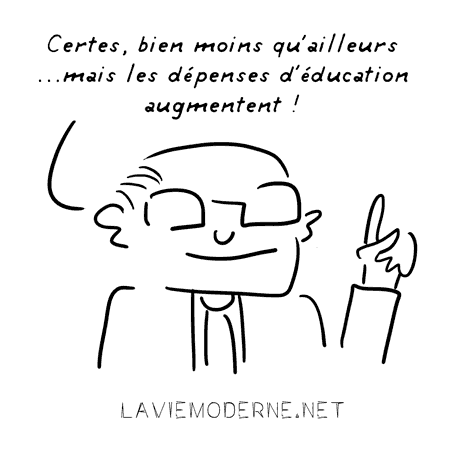
« En particulier, entre 2008 et 2012, les mesures prises dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) n’ont pas eu pour conséquence de réduire le budget de l’éducation nationale. Celui-ci a augmenté, en euros courants, de 5,4 % au total et de 0,8% hors cotisations retraites au compte d’affectation Pensions. »
Sauf à revenir sur le régime de retraites des fonctionnaires (qui n’a pas grand-chose à voir avec une mauvaise gestion des enseignants), seule la dernière augmentation de +0,8% est à prendre en compte. Or l’évolution des effectifs des premier et second degré entre les rentrées 2008 et 2011 est de presque 150.000 élèves supplémentaires (soit + 1,2%)4. Pas de prodigalité particulière du Ministère, donc.
Par ailleurs, l’évolution des dépenses d’éducation n’est qu’un indicateur secondaire par rapport au montant par lui-même de ces dépenses. Cette fois, la Cour des comptes argue de la valeur relative de ces dépenses, sans évoquer leur valeur absolue : les chiffres ne disent bien que ce que l'on veut leur faire dire.
Le montant des dépenses d’éducation
Il est vrai que les dépenses publiques d’éducation en elles-mêmes5 sont plus importantes en France en valeur relative qu’en Allemagne par exemple : 5,9% du PIB contre 5,1% du PIB. Mais elles sont comparables à celles des Pays-Bas (5,9%) et correspondent à la moyenne de celles de l’OCDE (5,8%), comme ses performances. La dépense relative de la France n’est donc pas excessive mais simplement moyenne. Ces dépenses en valeur relative n’en restent pas moins un indicateur insuffisant, chaque pays ayant un PIB et une démographie différents.
Par ailleurs, pour évaluer ces dépenses en valeur absolue, la Cour biaise quelque peu :
« Ainsi, alors que la rémunération des enseignants est moins élevée en France, le coût par élève de l’enseignement secondaire est supérieur de 15 % à la moyenne de l’OCDE (respectivement 10 696 USD contre 9 312 USD), sans résultat notable sur les performances des élèves » (p. 111)
Or, comme nous l’avons déjà vu, les performances des élèves ne sont évaluées par PISA que jusqu’à 15 ans. Les performances des élèves après le second cycle du secondaire (lycée) n’ont pas fait l’objet de comparaisons internationales. Si l’on consulte les tableaux de l’OCDE6, pour le premier cycle du second degré (le collège), la France est parfaitement dans la moyenne de l’OCDE (9.111 USD contre 8.954 USD) et bien en dessous des Pays-Bas (11.708 USD).
Notre propre tableau renseigne plus utilement sur les dépenses en valeur absolue de la France, inférieures jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire :
Dépenses annuelles des établissements d'enseignement par élève en 2009
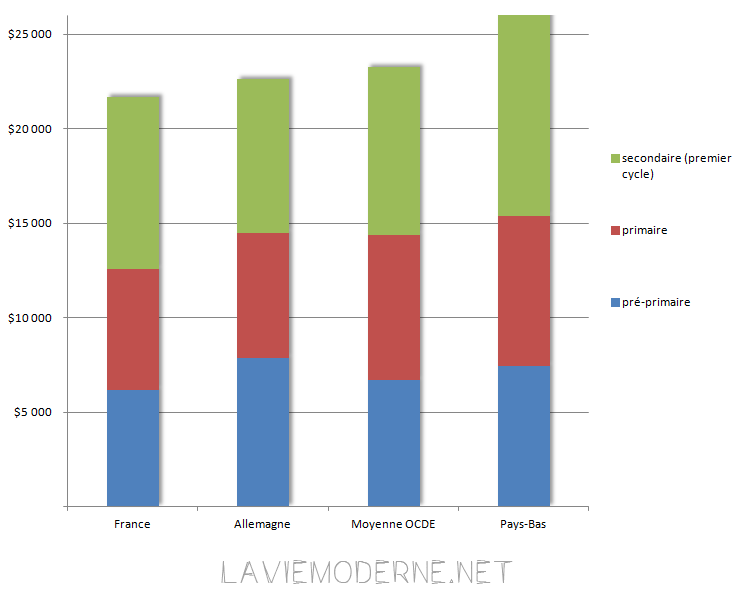
Source : OCDE, Regards sur l’éducation 2012, tableau B1.1a. Données manquantes pour le Canada.
Conclusion de ce graphique : pour des résultats scolaires dans la moyenne, la France dépense beaucoup moins jusqu’à la fin du premier cycle du secondaire que la moyenne des pays de l’OCDE. La moyenne de l’OCDE est en effet supérieure de 7% à la France (et celle de l’Union Européenne de 10,6%). En 2009 les dépenses annuelles des établissements d'enseignement par élève, tous services confondus aux Pays-Bas sont supérieures de 25% à celles de la France de la maternelle à la fin du premier cycle du secondaire, pour un score supérieur de 2,6% aux évaluations PISA 2009 : en quoi les Pays-Bas constituent-ils un modèle à suivre pour la France ?
Il est vrai que les dépenses en valeur absolue sont plus grandes en France dans le second cycle du secondaire (au lycée), pour des raisons structurelles (corps des agrégés, établissements de fin de carrière, filières professionnelles, etc.), mais une telle considération sort du champ de la réflexion sur les performances du système éducatif évaluées en CM1 ou à 15 ans. Ajoutons qu'en 2009 la réforme du lycée professionnel (en trois ans et non plus quatre) venait d'entrer en vigueur en France.
Il faut donc le proclamer haut et fort : le système éducatif français, sans briller, est donc économique et plutôt efficace. Mais ça ne peut pas être grâce à ses enseignants bien sûr !
La démographie aux oubliettes
La comparaison brute des dépenses relatives ou absolues omet encore une donnée d’importance : la démographie spécifique de chaque pays. Cet aspect n’étant jamais évoqué dans le rapport, la Cour des comptes supposant en effet que l’Allemagne ou la France ont des démographies identiques.
Or la France est l’un des pays à la démographie la plus dynamique de l’Union européenne, et ce depuis de nombreuses années. La comparaison des taux de fécondité ou des pyramides des âges suffit pour s’en convaincre. Dans ces conditions, la France ayant beaucoup plus d’élèves que ses voisins allemand ou néerlandais, il est intéressant de mettre en rapport deux éléments :
Comparaison des dépenses publiques d’éducation
et de la population de moins de 15 ans en 2009
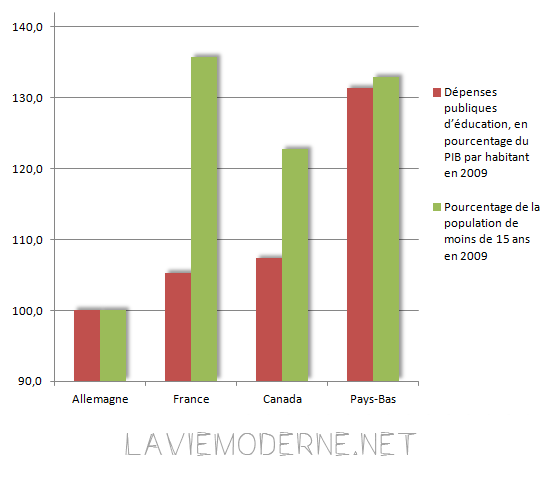 Base 100 pour l’Allemagne en 2009. Source : Banque mondiale7, OCDE8
Base 100 pour l’Allemagne en 2009. Source : Banque mondiale7, OCDE8
Ainsi la France consacre-t-elle aux dépenses publiques d’éducation en moyenne 5,2% de son PIB par habitant de plus que l’Allemagne, ce qui peut sembler beaucoup d’autant que les résultats PISA 2009 des deux pays sont identiques. Sauf que – contrairement à l’Allemagne – la France comporte une proportion de moins de quinze ans supérieure à l’Allemagne de 35% en 2009.
Alors qui, de la France ou de l’Allemagne, est le bon élève ?
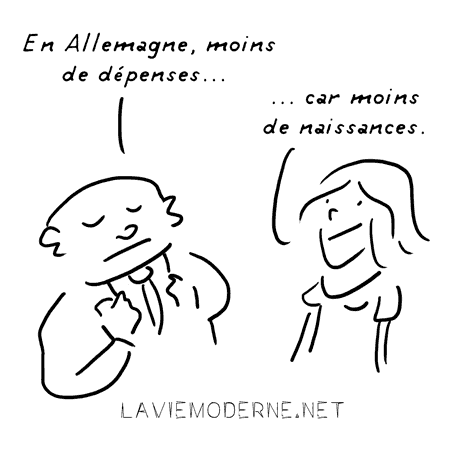
Fin de l'histoire ?
Ainsi appréciées, les dépenses d’éducation de la France et leur évolution sont plutôt malingres et ne permettent en rien de supputer une éventuelle mauvaise « gestion des enseignants » en France. Rien n’est plus faux que d’affirmer que « la France consacre à l’éducation des moyens comparables, voire supérieurs, à des pays qui assurent mieux la réussite de leurs élèves » (p. 135).
C’est donc sur ce constat que le rapport de la Cour des comptes aurait dû s’achever. Il ne fait pourtant que commencer…
La gestion des enseignants en cause
On va le voir, toutes les raisons sont donc bonnes – y compris les plus mauvaises – pour mettre en cause la « gestion des enseignants » en France. Sans doute celle-ci peut-elle être améliorée, comme toute gestion, mais il faut s’interroger sur la véritable intention qui fait la Cour des comptes n’interroger que cette seule cause.
Les enseignants trop nombreux ?
Le cliché est tenace et il est visiblement partagé par la Cour des comptes.
« Dans le second degré, l’évolution est plus marquée. Le nombre d’élèves a connu une baisse de 7,5 % entre les rentrées 1993 et 2009 ; en parallèle, le nombre d’enseignants a retrouvé son niveau de 1993 en 2009, après un pic à + 10,3 % à la rentrée 2002 » (p. 109).
La Cour n’hésite pas à présenter un graphique caricatural (p. 110) qui souligne en rouge vif l’augmentation du nombre des enseignants et la baisse du nombre des élèves depuis 1993. Ce graphique montre pourtant à partir de 2002 une baisse continue du nombre d’enseignants dans le second degré et même une reprise à la hausse du nombre des élèves à partir de 2008.
Mais surtout ces chiffres sont grossièrement trompeurs : il s’agit à nouveau de valeurs relatives puisque le graphique ne montre qu’une évolution. Qu’en est-il dans l’absolu ? La Cour ne le dit pas.
Contrairement à une idée reçue, le nombre moyen d’élèves par enseignant était en France en 2011 l’un des plus élevé de l’OCDE9 : 18,4 en primaire et 14,78 au collège (contre 16,31/14,16 en Allemagne et 15,39/13,28 pour la moyenne de l’OCDE). Ajoutons pour donner bonne mesure que dans le supérieur la situation est encore pire, avec 17,52 élèves par enseignants contre 11,39 en Allemagne. Seul le lycée est à exclure de ce constat. En vérité, en primaire, le nombre d’élèves par enseignants rend la France comparable à des pays comme la Tchécoslovaquie, la Turquie ou la Russie. La Chine elle-même fait mieux avec 17,12.
La Cour omet de le rappeler mais le taux d’encadrement en France est le plus bas de l’OCDE : « Avec 6,1 enseignants pour 100 élèves ou étudiants, la France est bonne dernière, loin derrière la Suède, connue pour son fort taux de fonctionnaires, mais aussi très en dessous de la Grèce ou du Portugal, où le taux d'encadrement monte à 9 professeurs pour 100 élèves ou étudiants. Plus précisément, si la France est dans la moyenne pour le collège et le lycée, avec un taux de 7,1 enseignants pour 100 élèves, elle dégringole pour le primaire et l'enseignement supérieur, où on ne compte que 5 enseignants pour 100 étudiants ou élèves10. »
Il n’y a donc pas trop d’enseignants, contrairement à ce que sous-tend l’affirmation d’une « gestion des enseignants » critiquable.
Dans ces conditions la Cour a beau jeu d’affirmer que la France « ne souffre pas d’un défaut de moyens » (p. 11).
Fort opportunément, la Cour s’abstient sur ces questions de toute comparaison internationale : la France est en effet l’un des pays de l’OCDE les plus économes en postes d’enseignants, avec des résultats scolaires dans la moyenne de l’OCDE. À ce titre l’Éducation nationale mérite encore une fois davantage d’être louée que fustigée par la Cour des comptes.
Par ailleurs le nombre des enseignants, en baisse constante depuis 2002, doit de plus être relativisé par un autre élément : les élèves sont de plus en plus nombreux à accéder au niveau Terminale et à obtenir le Bac. La réforme du Bac pro en trois ans en 2008 rendait certes plus courte la scolarité des bacheliers professionnels mais visait « à porter un plus grand nombre d'élèves au niveau IV de formation (baccalauréat) »11. D’où des records dans l’histoire de l’école républicaine comme en 2012 : 85% d’une génération au niveau Bac et 76,7% d’un génération obtenant le Bac12. Rappelons qu’en 1993 le taux d’accès d’une génération au Bac était de 54,7% (en pro 5,9%)13.
Des élèves beaucoup plus nombreux jusqu’au Bac supposent des professeurs plus nombreux dans le second degré, en particulier avec des filières professionnelles par définition plus coûteuses en postes (filières nombreuses, classes réduites pour des raisons matérielles).
Ce graphique montre pourtant tout le contraire :
Évolution comparée des résultats et du nombre d’enseignants dans le second degré de 2000 à 2012
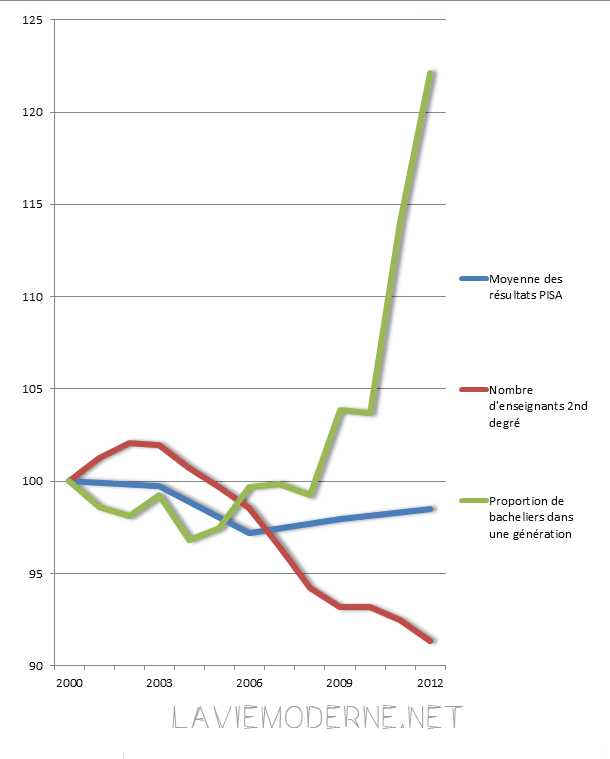
Base 100 en 2000. Sources : DEPP14, OCDE.
Deux facteurs peuvent expliquer en grande partie le grand écart entre la proportion de bacheliers dans une génération et le nombre de professeurs du second degré : la multiplication des heures supplémentaires et la suppression progressive des redoublements depuis trois décennies, contribuant utilement à la réduction de la durée de scolarisation15. Les parcours scolaires s’allongent mais leur durée se réduit, preuve d’une éclatante réussite !
Peu importe ces chiffres. Les véritables intentions de la Cour des comptes se dévoilent peu à peu : « Une gestion améliorée des ressources humaines de l’éducation nationale, dans le contexte fortement dégradé des finances publiques françaises, est une nécessité » (p. 112). Par « gestion améliorée » il faut comprendre « évolution de la masse salariale » (sic), doux euphémisme pour désigner une « baisse globale des effectifs » (p. 113).
Dans sa conclusion, la Cour récapitule ses propositions sous forme d’une « action coordonnée » sur plusieurs paramètres : « Elle seule est de nature à permettre une réduction importante du besoin en personnel enseignant, en particulier au niveau du lycée » (p. 141). Voilà qui a le mérite d’être clair : le rapport n’a qu’un seul crédo, une seule obsession : la baisse du nombre d’enseignants, si irrationnelle fût-elle. Voilà en vérité à quoi se résume la « gestion des enseignants ».
Prévenant la politique de la nouvelle majorité, la Cour proclame hautement que « Le problème n'est pas celui du nombre d'enseignants ou d'une insuffisance des moyens. »16
Les enseignants trop chers ?
On peut évidemment s’interroger sur la place d’une réflexion sur les rémunérations des enseignants dans un rapport consacré à leur « gestion ».
Et pour quelle raison la Cour insiste-t-elle sur la rémunération la plus élevée relevée dans son étude et dont elle donne le décompte précis ? C’est qu’un montant exceptionnel de 107.339€ pour un professeur de CPGE (p. 81) est sans doute plus propre à frapper l’imagination qu’une rémunération de 21.612€ en début de carrière dans le premier degré et qu’il faut calculer soi-même à partir de l’annexe p. 167.
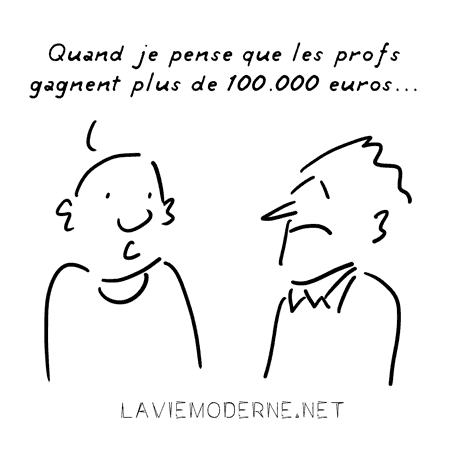
Dans son tableau n°8 (p. 103) la Cour concède bien, à partir des données de l’OCDE, que dans le primaire et le premier cycle du secondaire les rémunérations des enseignants sont inférieures en France de 15% à 20% par rapport à la seule moyenne de l’OCDE jusqu’à 15 ans d’exercice.
Salaires comparés du premier degré et du premier cycle du second degré en 2010
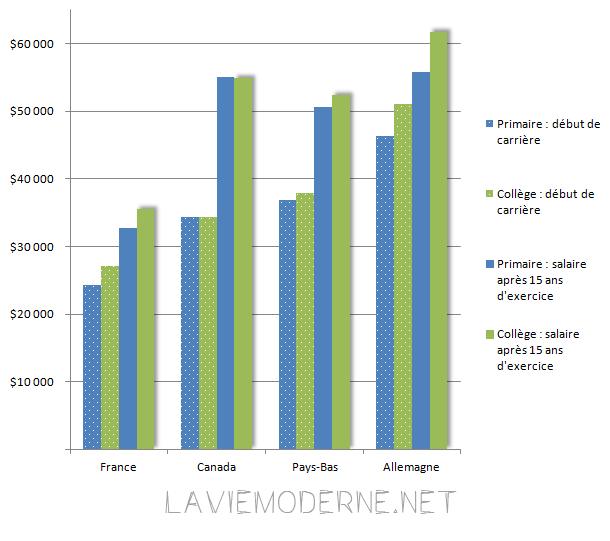
Source : OCDE17
On voit, dans ce graphique, que les professeurs à 15 ans d’exercice, dans le premier ou le second degré, peinent à atteindre en France le niveau des professeurs débutants dans les autres pays choisis par la Cour des comptes.
Mais la Cour relativise ces chiffres au prétexte qu’ils ne prendraient pas en compte les heures supplémentaires (ce qui ravira tous les enseignants du premier degré) et souligne même qu’« à l’échelon maximum dans le premier degré et au collège […] on observe un traitement légèrement supérieur pour les enseignants français » (p. 104) sans préciser qu’il faut 34 années d’ancienneté pour atteindre l’échelon maximum en France, contre seulement 24 années en moyenne dans les pays de l’OCDE18.
Il faut au passage comprendre que, dans l’esprit de la Cour des comptes, les heures supplémentaires font partie du traitement des enseignants : l’explosion des heures supplémentaires n’a évidemment rien à voir avec leur paupérisation progressive.
S’agissant de cette évolution des rémunérations la Cour prend des précautions oratoires et utilise le conditionnel (qu’elle n’utilise pas à propos de l’évolution des dépenses ou des performances du système éducatif français) :
« Les enseignants français auraient connu une perte de pouvoir d’achat sur les trois niveaux d’enseignement considérés, entre -7,0 et -8,3 % depuis 2000, alors que le pouvoir d’achat des enseignants des autres pays serait en moyenne en hausse, dans l’OCDE, comme dans les pays européens. » (p. 104)
Au contraire la Cour rappelle qu’il a été procédé à une « revalorisation indiciaire des premiers échelons des grilles en 2010 et 2012 » (p. 106), revalorisation en trompe-l’œil puisque cette mesure très économique n’a concerné que les professeurs néo-titulaires, dont les bas salaires devenaient criants. La Cour oublie en revanche de rappeler que le point d’indice de l’ensemble de la fonction publique est gelé depuis 2010.
Pour la Cour, ce n’est de toute façon pas le salaire des enseignants qui est en jeu, mais leurs indemnités. En effet le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux depuis 2007, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), devait s’accompagner d’un « retour catégoriel » qui s’est traduit dans l’Éducation nationale par différentes primes mais surtout par la prime aux trois heures supplémentaires : curieuse façon de « revaloriser » un métier que de contraindre à travailler plus pour gagner plus. Or ces indemnités sont de toute façon jugées insuffisantes :
« Le ministère n’envisage pas de remédier à la faible part des indemnités dans la rémunération. Il avance à cet égard l’argument du coût qui résulterait d’une telle réforme en raison de l’importance des effectifs concernés : les enseignants seraient victimes de leur nombre. Cette réponse conduit néanmoins à s’interroger sur les modalités de détermination du nombre d’enseignants. » (p. 107)
Dit autrement, on ne peut mieux rémunérer les enseignants parce qu’ils sont nombreux, dit le Ministère. Parce qu’ils sont trop nombreux, réplique ainsi la Cour des comptes.
Pour conclure, quand la Cour évoque « des moyens suffisants, une utilisation défaillante » (p. 136), on peut émettre des réserves sur les propres défaillances de la Cour. Et quand elle compare la performance de la France à d’autres pays (« Les exemples de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Canada montrent que des réformes ambitieuses permettent d’atteindre rapidement cet objectif » p. 135), on peut rappeler que l’effort porté par ces pays est plus grand en terme de dépenses publiques d’éducation, de taux d’encadrement et de rémunérations des enseignants.
Entre 2000 et 2010 « les salaires ont augmenté dans la quasi-totalité des autres pays de l’OCDE : pas loin de 20 % d’augmentation en moyenne car de nombreux pays ont décidé d’investir massivement dans le salaire des enseignants pour retenir les meilleurs d’entre eux dans la profession. »18
« Le ministère de l’éducation nationale a choisi de privilégier le nombre d’enseignants sur la rémunération » (p. 100) conclut la Cour des comptes.
A dire la vérité, ni l’un ni l’autre.
Le statut des enseignants en ligne de mire
Postulant une mauvaise « gestion des enseignants » très discutable, comme nous venons de le voir, la Cour désigne ensuite ce qui constitue le frein le plus notable à son « amélioration » : le statut des enseignants. La paupérisation des enseignants doit en bonne logique s’accompagner d’une dévalorisation de leur statut.
La Cour considère que l’enseignement reste fondé sur un modèle adapté à la période de 1950 (p. 11), comme si l’enseignement en France et même le statut des enseignants n’avait pas connu de profondes transformations depuis cette date. La date n’est pas évoquée au hasard : il s’agit bien sûr de s’en prendre au statut des enseignants datant de 1950.
« Tout au long du XIXème siècle et jusqu’à l’arrivée des classes d’âge nombreuses (1950-1960), les fonctions d’enseignant ont, de ce fait, été clairement distinguées de celles de répétiteur, chargé de la surveillance du travail personnel des élèves, ainsi que de celles de surveillant, chargé de ce qu’on appelle aujourd’hui la « vie scolaire ». Cette conception traditionnelle a progressivement évolué, en raison de plusieurs facteurs, scolaires et sociaux, notamment la démocratisation de l’accès aux études secondaires, l’allongement progressif de l’obligation scolaire, la perception croissante de la nécessité d’une lutte efficace contre l’échec scolaire, ainsi que la place revendiquée par les parents d’élèves dans les décisions affectant la scolarité de leurs enfants. » (p. 26)
A demi-mots, dans un aveu d’une candeur rafraîchissante, la Cour considère donc que l’enseignant est de fait devenu un « répétiteur » et un « surveillant » et appelle à prendre acte de cet état de fait en l’inscrivant dans son statut.
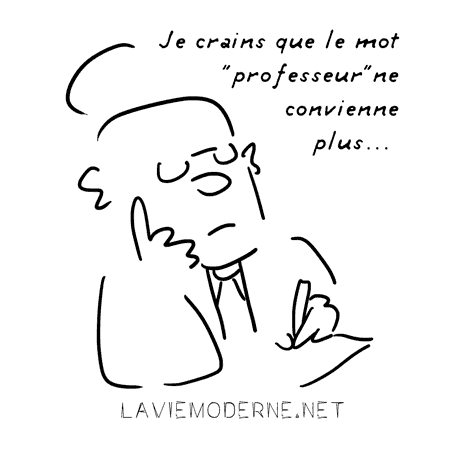
En annexe de son rapport, la Cour prend d’ailleurs l’exemple de l’Ontario où les enseignants du second degré sont astreints à des « tâches pédagogiques complémentaires » comme « suppléance interne, surveillance, mentorat » (la surveillance est donc une « tâche pédagogique »). Dans ce beau pays le droit de grève est d’ailleurs interdit pour les enseignants : voilà qui est infiniment plus moderne !
La « modulation » des obligations de service
« Les missions des enseignants recouvrent, au-delà des heures de cours dans la classe, un ensemble d’activités individuelles et collectives liées à la fonction enseignante, mais la gestion du ministère demeure centrée sur les seules heures de cours. » (p. 21)
La Cour des comptes déplore – dans l’intérêt des enseignants bien sûr – que le métier soit défini par un temps de service (« seule obligation » p. 44) et non en forfait global d’heures de travail. Et de rappeler toutes les missions des enseignants, lesquelles n’ont pourtant rien de bien nouveau : documentation, préparation des cours, correction des travaux des élèves, rencontres avec les parents, aide au travail personnel, conseils d’orientation, etc.
La Cour des comptes peste contre cette liberté qu’ont les enseignants, en qualité de cadres de la fonction publique, pour mener à bien ces missions, dont certaines sont rémunérées en indemnités ou en heures supplémentaires. Elle propose d’intégrer toutes ces charges dans le service des enseignants, de permettre au chef d’établissement de « moduler » les « obligations de services » des enseignants (p. 97) et donc tout simplement d’abolir le cadre national de ces obligations ! Par modulation il faut évidemment comprendre ajout d’obligations de service nouvelles correspondant par exemple aux charges d’un « répétiteur » et d’un « surveillant ».
De nombreux candidats aux élections présidentielles passées ou à venir, de gauche ou de droite, ont déjà proposé d’augmenter le service des enseignants. Bien sûr la Cour omet de rappeler que la profession enseignante n’a connu aucune réduction du temps de travail depuis 1950.
Pour un régime « indemnitaire »
La réforme du statut des enseignants est bien sûr appelée au nom d’une noble cause: la lutte contre les inégalités entre les enseignants et la dénonciation de « situations inéquitables » (p. 80)
La Cour des comptes dénonce en effet – à corps égal – les disparités des rémunérations des enseignants. Or les heures supplémentaires, qui n’ont rien d’obligatoire, expliquent à elles seules la moitié des écarts de rémunération (p. 82) : depuis 2002 les heures supplémentaires ont augmenté de 13,5% et 73% des professeur du second degré public font aujourd’hui au moins une heure supplémentaire, ce qui a compensé en partie la baisse de leur nombre et a permis à l’État de substantielles économies. Il ne s’agit donc pas d’inégalités, mais de choix individuels.
Par ailleurs lorsque la Cour pointe les écarts entre les heures supplémentaires des professeurs en début et en fin de carrière, elle oublie de rappeler que la paupérisation progressive des enseignants depuis plusieurs décennies explique précisément ces disparités. Pour le dire autrement, ce ne sont pas les heures supplémentaires qui créent des inégalités entre les enseignants, c’est la médiocrité des salaires.
Il est évident en revanche que des obligations de services et des indemnités différentes, réparties à la seule discrétion du chef d’établissement, seraient à même de remettre de l’égalité entre les enseignants.
Évidemment la Cour des comptes ne dénonce pas les inégalités dont sont victimes les contractuels recrutés par l’Éducation nationale puisqu’ils lui permettent d’économiser des postes d’enseignants. Le contractuel est au fond un modèle vertueux dans l’éducation idéale de la Cour des comptes, qui déplore d’ailleurs que le recrutement d’un enseignant ne fasse pas l’objet d’un « contrat de travail » (p. 82).
A bien y réfléchir le régime indemnitaire a cette vertu de ne pas augmenter le traitement de tous les enseignants, mais à répartir leurs rémunérations de façon différenciée. Bref qu’il permet de mieux payer non pas les enseignants mais certains d’entre eux, le tout sans peser sur les retraites (les indemnités n’étant pas prises en compte dans leur calcul).
Les corps en fusion
La dénonciation des écarts de rémunération entre professeurs du premier degré et du second degré (malgré des grilles salariales communes depuis 1989) permet de faire oublier que les uns comme les autres sont surtout bien moins rémunérés que dans tous les pays donnés comme exemples. En Allemagne l’écart de salaires à 15 ans d’exercice entre un professeur du primaire et un professeur du collège est plus prononcé qu’en France.
En réalité cette dénonciation est un cheval de Troie pour aligner les services et rapprocher les statuts dans la perspective d'une école fondamentale, tout comme le socle commun des compétences qui suppose, aux yeux de la Cour, une « transition école-collège » qui mette fin à une « vraie rupture » (p. 45), à une « étanchéité » (p. 40) dont personne ne comprend en quoi elle serait aujourd’hui problématique pour les élèves mais dont on comprend surtout qu’elle ne concerne pas que les élèves. Il s’agit de primariser le statut des enseignants au collège, tant du point de vue des obligations de service et de l’annualisation que de la polyvalence disciplinaire.
Curieusement la Cour ne conteste pas les différences de traitement entre certifiés et agrégés à poste équivalent par exemple, même si elle considère – à juste titre – que les agrégés devraient par principe enseigner au lycée. À cet égard, en supposant que tous les agrégés enseignent au lycée, la Cour des comptes ne s’interroge pas sur les inégalités salariales entre le tiers d’agrégés et les deux tiers de certifiés qui y resteraient encore.
Chose amusante au passage : cette recommandation que les agrégés enseignent tous au lycée (p. 60) ne peut qu’alourdir encore le coût du second cycle du secondaire, coût que la Cour dénonce vivement par ailleurs. En effet il y aurait au lycée plus de professeurs payés presque un tiers de plus : un rapide calcul montre qu’un tel transfert alourdirait de 3,5% le coût du 2e cycle de l’enseignement secondaire !
La « polyvalence » comme horizon
Après les obligations de service, la distinction en corps, la Cour s’attaque à un autre aspect du statut des enseignants : son caractère disciplinaire. Autant qu’à un établissement, la Cour des comptes critique le rattachement à une discipline. La raison en est évidemment pédagogique, et seulement pédagogique : « La monovalence disciplinaire des enseignants du second degré oblige par ailleurs à une gestion complexe des disciplines. » (p. 46) ; « La monovalence des enseignants remplaçants rend difficile l’adéquation entre les besoins de remplacement et les remplaçants disponibles » (p. 47) ; « La notion de discipline qui est structurante dans le second degré peut entrer en contradiction directe avec la logique collective » (p. 54).
De ce point de vue la gestion moderne des enseignants ressemble furieusement à une bonne vieille gestion du XXe siècle, quand ont été créés les PEGC, ces enseignants bivalents et sous-payés recrutés à partir de 1969 pour faire face à la massification de l’enseignement.
La Cour ne recommande pas seulement la bivalence, comme dans les lycées professionnels ou comme dans les lycées généraux en Allemagne (mais sans la rémunération correspondante) mais tout simplement la « polyvalence » des professeurs du premier cycle du second degré. Il est vrai que si les enseignants pouvaient enseigner toutes les disciplines, leur gestion s’en trouverait simplifiée ! Et la Cour de trouver le Ministère beaucoup trop timoré : « Pour y répondre, le ministère n’évoque que des expérimentations visant à favoriser la polyvalence dans les premières classes du collège. » (p. 45)
Sans oublier tout ce qui ne relève pas du disciplinaire à proprement parler, bien entendu. Répétiteur, surveillant, enseignant dans de multiples disciplines: le professeur du second degré doit devenir une sorte d’homme-orchestre prêt pour l’improvisation.
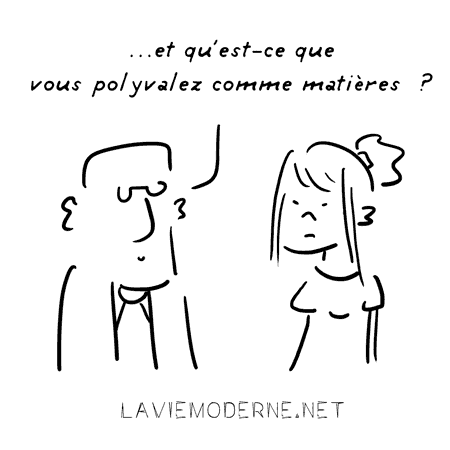
Bien sûr, une telle recommandation est dans l’intérêt des élèves mais même des enseignants eux-mêmes : la Cour s’offusque ainsi que les lauréats de deux Capes soient sommés de choisir entre les deux. La liberté de l’enseignant suppose en effet qu’il puisse enseigner celle des deux qu’on lui enjoindra sans ménagement d’enseigner !
Dans cette perspective la Cour semble déplorer que les actuelles « mentions complémentaires » exigent un « haut niveau de maîtrise de la discipline » (p. 49) et regretter la disparition des PEGC : « le diplôme dont ils disposaient n’étant pas validé par l’université, la maîtrise par les PEGC des disciplines qu’ils enseignaient faisait l’objet de vifs débats ». Pour la Cour des comptes, voilà en tout cas ce qui ne ferait pas débat.
La liberté pédagogique au rebut
La Cour montre une préoccupation singulière, car on ne voit guère le rapport avec la « gestion des enseignants », pour les méthodes de travail des enseignants.
Rappelant que, selon le Code de l’éducation, les enseignants « travaillent au sein d'équipes pédagogiques » (Article Article L912-1), elle en conclut – par un saisissant raccourci – à la « dimension collective du travail » des enseignants (p. 51). Or le Code de l’éducation ne dit rien de tel : il précise que les équipes pédagogiques sont simplement « constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ». Et si la Cour rappelle les limites de la liberté pédagogique (p. 53), le même Code de l’éducation indique précisément que le conseil pédagogique ne peut porter atteinte à la liberté pédagogique (Article L912-1-1).
Mais, postulant par principe que le travail en équipe contribue à l’amélioration des résultats, la Cour persiste :
« La profonde évolution des missions des enseignants, sous l’effet de réformes pédagogiques récentes, contribue à renforcer la dimension collective de l’exercice du métier d’enseignant. Par exemple, la référence au socle commun, qui définit des compétences que tous les élèves doivent maîtriser à l’issue de la scolarité obligatoire, ou le développement de l’accompagnement personnalisé exigent un net renforcement de l’interdisciplinarité et du travail en équipe. » (p. 52)
En réalité le « travail en équipe » revêt, dans l’esprit de la Cour des comptes, une dimension très particulière.
Prenant l’exemple de l’Allemagne, des Pays-Bas ou du Canada, où certains professeurs exercent des « fonctions de management » (p. 58), elle déplore en effet le manque de « cadre intermédiaire » (p. 58) ou de hiérarchie entre les enseignants (p. 122) qui pourrait fonder un régime indemnitaire au mérite, dans un esprit de joyeuse concurrence : rappelons que la Cour appelle à une revalorisation « par une réévaluation pécuniaire mais portant sur le montant des indemnités et non sur celui du traitement indiciaire » (p. 139). Elle donne l’exemple des établissements de l’enseignement catholique visités où des professeurs responsables ont la charge de réorganiser l’emploi du temps en cas d’absence (p. 123). Le « travail en équipe » s’apparente davantage à un travail en brigades.
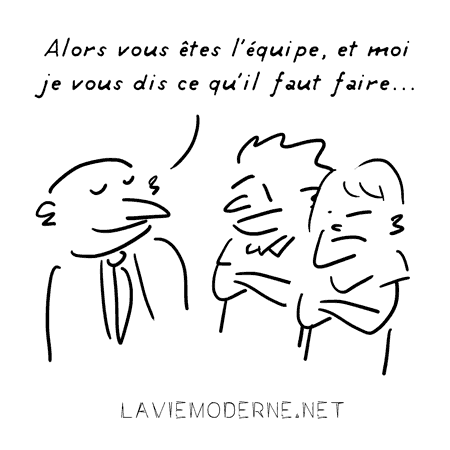
D’ailleurs, dans sa fougue pédagogique réformatrice, la Cour des comptes n’évoque pas le petit problème que constitue le manque cruel de locaux pour ce travail en équipe.
Il est amusant de noter qu’à plusieurs reprises dans le rapport la Cour est prise en flagrant délit de contradiction à propos du travail en équipe. Ainsi lorsqu’elle déplore le manque de pouvoir décisionnel des chefs d’établissement (« Dans le second degré […] il est fréquent que la répartition des classes fasse l’objet de propositions des équipes enseignantes plus ou moins fermes, le chef d’établissement n’intervenant que dans des cas particuliers ou problématiques » p. 57). De même lorsqu’elle fustige la mauvaise répartition des postes dans chaque académie, mise sur le compte de la mauvaise volonté des établissements souhaitant conserver des postes.
L’évaluation au rabais
Pour la Cour des comptes l’évaluation des enseignants ne convient pas sous sa forme actuelle, puisqu’elle n’offre « aucun cadre national clair en lien avec les mission » (p. 24). Curieuse logique que celle de la Cour : il faudrait donc que les obligations de service des enseignants soient différenciées et définies localement mais que leur évaluation obéisse à des critères uniformes et nationaux !
Dans son rapport la Cour exprime toute l’estime qu’elle porte au travail des inspecteurs pédagogiques :« Par exemple, alors que les inspections ont notamment pour objectif l’amélioration des pratiques, elles sont généralement peu fréquentes et laissent place à d’autres préoccupations (comme la notation et ses conséquences pour l’avancement). »
Alors qu’elle énumère par ailleurs toutes les fonctions des inspecteurs (p. 129), la Cour ne fait aucun rapprochement entre la frénésie des réformes qui se succèdent et le nombre insuffisant d’inspecteurs chargés de veiller à leur application autant que d’inspecter les professeurs. Peu importe : les inspections insuffisamment nombreuses suffisent à disqualifier le principe même d’évaluation pédagogique : la Cour ne recommande pas des inspections plus nombreuses.
Elle ne considère de toute façon la note pédagogique que comme un simple « accessoire » qui « ne peut refléter l’ensemble de ses dimensions, complexes, de contrôle du contenu des enseignements et du comportement des enseignants, ainsi que d’accompagnement et de contribution à l’amélioration des pratiques. » (p. 85). On retrouve ici, comme pour la polyvalence ou les obligations de service, toute l’estime de la Cour pour les disciplines d’enseignement, considérées comme secondaires.
La Cour n’hésite pas à laisser entendre que les chefs d’établissement n’évaluent pas les enseignants (p. 44) et regrette qu’ils ne disposent pas du pouvoir d’inspection (p. 56), y compris pédagogique : « contester au chef d’établissement toute légitimité pour évaluer la qualité pédagogique d’un enseignant ne relève pas de l’évidence, dès lors que nombre de systèmes éducatifs étrangers opèrent un choix inverse » (p. 58). Une chose est sûre : conférer au chef d’établissement cette légitimité relève bien « de l’évidence » pour la Cour des comptes (sans plus de justification d’ailleurs), laquelle, entrant dans le champ politique, déplore que l’actuelle majorité ait abrogé en mai 2012 le décret de l’ancienne majorité portant sur une telle réforme.
« Que ce soit aux Pays-Bas, dans le Land de Berlin, en Ontario, en Corée ou en Finlande, le chef d’établissement, ancien enseignant, est au contraire perçu comme le mieux à même d’évaluer le travail en classe des enseignants, quelle que soit leur discipline d’enseignement. » (p. 57)
Malheureusement, le rapport l’indique lui-même (p. 119) : un lauréat sur cinq des concours de recrutement de personnels de direction en France en 2010 n’était pas un enseignant. Sur les effets pervers d’une telle réforme, on peut se référer à l’article inaugural de La Vie moderne en 2012 : « Notez-les tous ! ».
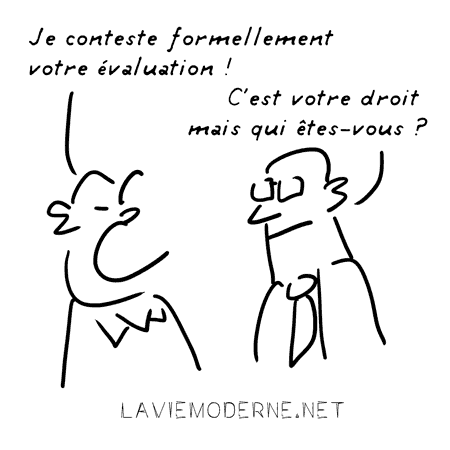
Au fond les préoccupations pédagogiques sont très secondaires : la Cour donne comme exemple les IEN dans le primaire, capables d’imposer aux enseignants des remplacements. Voilà la vraie finalité d’une évaluation par le chef d’établissement : en faire le vrai patron des professeurs.
A vrai dire la Cour va plus loin, encore en suggérant par exemple que l’évaluation des enseignants ne soit plus individuelle mais collective (p. 55), puisqu’elle prône le travail en équipe. Il est vrai que pour un chef d’établissement sans compétence pédagogique dans une discipline donnée il est plus facile d’évaluer le travail en équipe que la compétence disciplinaire d’un enseignant.
Mais non seulement la Cour des comptes critique les modalités de l’évaluation des enseignants (par un inspecteur pédagogique, individuelle), mais elle va jusqu’à en critiquer les critères mêmes. Le principe même de l’ancienneté semble en effet problématique : « le barème reflète mal l’investissement et le mérite » (p. 85). La Cour constate bien un écart des rémunérations selon l’avancement (16,4%) mais déplore le manque de « ressenti » des enseignants ! Il faudrait donc que bons et mauvais enseignants « ressentent » davantage les écarts de salaire. Voilà une école qui fait rêver.
En réalité le problème n’est pas tant le barème lui-même, qui – si imparfaitement soit-il – prend bien en compte le mérite et l’investissement, puisqu’il procède d’une double notation (par le chef d’établissement et par l’inspecteur pédagogique) mais les quotas qui régissent le passage d’un grade à l’autre : ainsi 7% seulement des promouvables à la hors-classe dans le second degré et 2% dans le premier degré sont effectivement promus.
Encore une fois, les raisons du dysfonctionnement ne sont pas structurelles, mais économiques. La Cour ne recommande pas la suppression ou seulement le relèvement des quotas : la rémunération au mérite ne doit rien coûter à l’État.
Pour un recrutement moderne
Changer le statut des enseignants suppose également de changer leur mode de recrutement.
Face à la pénurie de plus en plus criante des candidats aux concours de l’enseignement19, la Cour constate bien « la crise d’attractivité » du métier d’enseignant (p. 139), doux euphémisme pour un métier devenu repoussoir, même en période de crise économique prolongée. Mais cette crise, la Cour l’attribue à la réforme des conditions de recrutement de 2010 alors même qu’elle est sensible depuis la fin des années 1990. De ce point de vue il ne s’agit plus d’une « crise » mais d’une pénurie endémique qui affecte le niveau de compétence des enseignants recrutés.
La Cour des comptes considère que le mode de recrutement n’anticipe pas suffisamment le « nombre optimal d’enseignants » à recruter chaque année (p. 107). Selon elle, le Ministère de l'Éducation nationale devrait pouvoir connaître ce nombre cinq ans à l’avance. Le Ministère doit pouvoir anticiper le nombre de naissances, de départs en retraites volontaires, les grandes réformes du quinquennat suivant ou les filières d’orientation que choisiront au lycée les élèves de CM2 : curieuse vision de l’adéquation aux « besoins des élèves »…
On le voit : nombreuses sont les intolérables incertitudes humaines qui s’opposent à une gestion rationnelle des enseignants.
L’affectation, principe désuet
Pourtant la Cour des comptes se contredit encore une fois en promouvant un recrutement non plus national mais local. Elle conteste au fond le principe même de l’affectation, dont elle ne veut pas reconnaître les vertus.
« Ni les compétences propres des candidats, ni la singularité du poste visé du point de vue des besoins des élèves, ni a fortiori l’adéquation entre ces deux critères ne sont retenues. » (p. 74)
Comprendre qu’un poste aux Mureaux est fondamentalement différent d’un poste à Versailles. Sans doute mais en quoi ? La Cour se garde bien de le dire. Comprendre également que deux professeurs d’une même discipline ne se caractérisent plus par leur compétence disciplinaire mais par leurs « compétences propres » dont la Cour – qui peste déjà contre la lourdeur des concours – ne dit quelles elles sont ni comment elles doivent être reconnues institutionnellement.
« La procédure ne prévoit pas d’entretien avec le candidat et le curriculum vitae est une pièce inexistante dans le traitement des candidatures »
La Cour des comptes, qui fustige par exemple les 1.600 heures de réunion nécessaires pour faire respecter le barème dans l’académie de Versailles, recommande donc en bonne logique d’alourdir et d’allonger la procédure en organisant plusieurs entretiens individuels pour chacun des 6.000 professeurs et plus qui demandent chaque année leur première affectation ou mutation dans cette académie. Voilà qui risque en effet de simplifier les choses. Bien entendu : un tel recrutement ne pourra être effectué que par le chef d’établissement lui-même (p. 129), déjà chargé d’évaluer les enseignants.
Le recrutement dans les établissements difficiles
Avec un certain retard la Cour des comptes semble découvrir – non sans ingénuité – le problème de l’affectation massive des néo-titulaires dans les établissements difficiles et par conséquent de l’instabilité endémique des équipes éducatives. Sur ces postes rarement demandés, malgré une indemnité et une bonification indiciaire, son regard est très distancié :
« Si cette notion d’attractivité est en partie subjective, il demeure que les postes de remplaçant et les postes dans les établissements connaissant le plus la difficulté scolaire sont généralement perçus comme moins attractifs. » (p. 88)
La Cour reconnaît pourtant que les professeurs quittent en moyenne ces établissements difficiles au bout de 1,2 an (p. 90), mais n’en doutons pas : ils fuient sans doute en toute subjectivité.
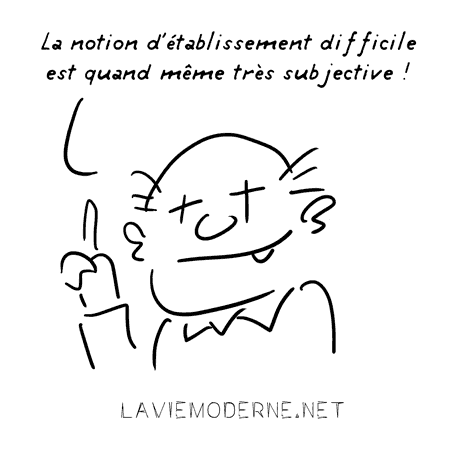
Pour la Cour la solution est pourtant simple : comme pour tous les établissements il faut y recruter les professeurs « en fonction de l’adéquation de leurs compétences et de leur parcours avec les besoins des élèves et le projet de l’école ou de l’établissement » (p. 97). À vrai dire on se demande bien quelles sont les compétences non disciplinaires et le « parcours » d’un(e) professeur néo-titulaire. Pour les autres, certains seraient donc, en vertu de leurs « compétences propres », voués à enseigner dans ces établissements. Évidemment la Cour des comptes ne précise pas de quelles « compétences » il s’agit. Et pour cause : seule l’expérience donne compétence à enseigner dans ces établissements. Sans craindre de se contredire, la Cour critique par ailleurs les professeurs restés longtemps en poste dans les établissements difficiles et accusés de manquer de « motivation entretenue de façon continue » (p. 90).
Les établissements les plus difficiles ayant déjà beaucoup de mal à voir leurs postes pourvus (un seul poste sur deux couvert à l’issue du mouvement dans les établissements difficiles p. 95), on imagine le succès d’un recrutement exigeant un entretien, une expérience et des « compétences propres » pour rester ensuite à demeure dans un établissement difficile ! C’est d’ailleurs déjà le cas avec le recrutement dérogatoire dans les établissements ECLAIR où de nombreux postes restent sans demande (p. 91).
De même la Cour dénonce l’affectation de professeurs remplaçants dans ces établissements lors même que ces affectations seules permettent de faire face à la pénurie aux concours de recrutement. Il ne s’agit pas pour elle de doter ces établissements d’enseignants supplémentaires, mais – comme pour le temps de service – de « moduler » le nombre de postes à répartir entre les établissements difficiles et les autres. Bref de gérer autrement la pénurie.
Le système d’affectation est certes problématique en l'état mais les solutions avancées par la Cour de comptes sont – comment dire ? – bien naïves.
L’exemple - très pertinent - …de l’enseignement privé
Ne reculant devant aucun tabou la Cour revendique d’avoir pour la première fois inclus dans ses investigations l’enseignement privé, suivie en cela par la médiatrice de l’Education Nationale.
« L’enseignement privé sous contrat connaît, lui aussi, une attractivité différenciée entre académies, mais de manière atténuée. En effet, les modalités de recrutement conduisent à ce que les candidats choisissent, sous réserve de l’accord de la direction, l’établissement qu’ils sont prêts à accepter dès leur première affectation. Lors de l’enquête, cette particularité a été citée à la Cour par de nombreux enseignants comme une des motivations importantes du choix de l’enseignement privé par rapport à l’enseignement public. » (p. 93)
Voilà donc le modèle de recrutement que la Cour propose aux enseignants du public en lieu et place des affectations : choisir son académie ainsi que l’établissement qu’on est « prêt à accepter ». Un modèle facile à généraliser dans le public et qui risque de remporter un franc succès dans nos académies déficitaires et nos établissements difficiles !
La Cour oublie évidemment de rappeler ce qui peut rendre les établissements privés plus « attractifs » comme la taille réduite des établissements privés (les lycées privés présentent en moyenne 119 candidats au Bac contre 295 pour les lycées publics) ou la sélection des élèves puisque l’enseignement privé n’est malheureusement pas intéressé à la « réussite de tous les élèves ».
Le petit miracle de l’annualisation
Le nombre d’heures supplémentaires constitue en réalité moins un motif d’inégalité entre les enseignants qu’une insupportable charge budgétaire aux yeux de la Cour des comptes : elle s’insurge d’ailleurs contre le temps de service hebdomadaire des enseignants. Il est vrai que l’annualisation permettrait d’inclure toutes les « missions » nouvelles des enseignants dans un temps de service annualisé, conçu extensivement. L’annualisation (insuffisante encore) dans le primaire montre la voie (p. 31) : quand on connaît les salaires des enseignants du primaire, on comprend mieux où la Cour des comptes veut en venir.
En donnant des exemples de temps de travail annualisé la Cour laisse entendre que les enseignants français travaillent moins que leurs homologues étrangers.
Or, à bien y regarder, les exemples étrangers ne vont pas nécessairement dans ce sens : ainsi, prenant l’exemple de l’Ontario, la Cour constate que le service des enseignants est de 25h dans l’élémentaire (dont 21h de cours, le reste pouvant inclure le temps de la « préparation de cours » p. 33) : rappelons que les enseignants français du primaire doivent assurer 24h de cours par semaine et consacrer 3h par semaine à d’autres tâches que la préparation des cours. Autre étrangeté de l’Ontario : « Il s’agit d’un forfait global, qui ne couvre pas la totalité du temps de travail hors heures de cours, mais qui assure, pour les enseignants comme pour l’administration, une prise en compte dans le service des activités hors heures de cours » (p. 33). La Cour ne donne aucune précision sur l’intérêt d’une telle « prise en compte » qui reste d’ailleurs bien évasive puisque ce forfait global « ne couvre pas la totalité du temps de travail ». Et elle omet évidemment de préciser que les enseignants au Canada perçoivent des salaires autrement plus élevés que les enseignants français (voir le graphique sur les comparaisons de salaires) pour des obligations de service concrètement mesurables inférieures.
Autre exemple de répartition « adaptée » du temps de travail : 750h d’enseignement maximum aux Pays-Bas dans le second degré (p. 33), ce qui correspond à 20,8h par semaine. Or la moyenne de service constatée, dans l’académie de Versailles, prise en exemple par la Cour des comptes (moyenne incluant agrégés dont le service est de 15h et professeurs à temps partiels), est de 19,34h pour le second degré, soit presque 700h par an.
De même, si l’on se fonde sur l’enquête20 citée par la Cour des comptes (datant de 2008, soit avant l’explosion des heures supplémentaires), le temps de travail annualisé est de 1668h pour un certifié, contre 1659h aux Pays-Bas (p. 33).
Bref, difficile de conclure que les enseignants français travaillent moins que leurs homologues. Ce qui n’empêche pas la Cour d’affirmer, sans en apporter la moindre justification, que l’annualisation doit constituer le facteur principal d’« amélioration des modalités de gestion des personnels » (p. 140).
L’annualisation, sous couvert de prendre en compte les nouvelles missions supposées des enseignants, est en réalité la porte ouverte pour rendre obligatoires des tâches supplémentaires : temps de service extensible, remplacements, tutorat, projet ou travail interdisciplinaire, travail en équipe voire simple surveillance. Ajoutons des heures de soutien ou d'école ouverte pendant les vacances scolaires, puisque avec l'annualisation il n'y aura plus de semaine scolaire ou non scolaire.
En imposant un temps de travail annualisé, il s’agit de transformer des cadres gérant librement leur temps de travail pour effectuer une mission en ouvriers aux pièces, caporalisés, sommés de rendre des comptes et d’effectuer des tâches précises, nouvelles et minutées, selon un système taylorisé par ailleurs impossible à mettre en place.
Pour un emploi du temps flottant
Avec une candeur désarmante la Cour, pestant contre l’emploi du temps hebdomadaire fixe des élèves et des professeurs, fait une proposition pleine de créativité et de poésie, assez cocasse pour qui connaît déjà la difficulté d’élaborer des emplois du temps annuels : « construire des emplois du temps pour chaque semaine et mobiliser les enseignants à la demande » (p. 36). On imagine bien l’usine à gaz d’emplois du temps (avec changement de salles) et de classes (avec changements de groupes et de listes d’appel) qui varieraient chaque semaine et le chaos permanent instauré au sein des collèges et des lycées : l’organisation de l’« accompagnement personnalisé » (sic) en donne déjà un bon aperçu au lycée.
C’est d’autant plus amusant que la Cour déplore par ailleurs le manque de « continuité » pour les élèves entre le primaire et le collège !
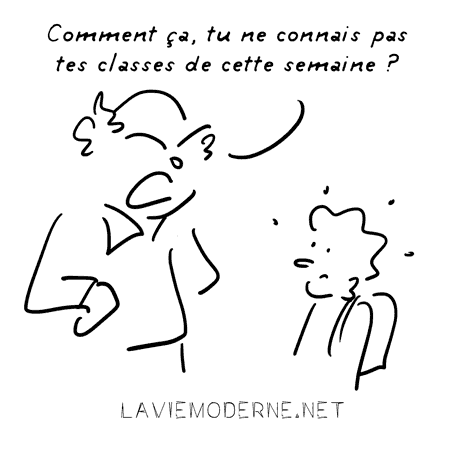
Bien sûr c’est l’intérêt de l’élève qui commande d’annualiser le temps de travail des enseignants : « Les heures de cours sont programmées de façon fixe, sans correspondre nécessairement aux besoins des élèves. » (p. 36).
À l’évidence le principe même de continuité pédagogique, essentiel à l’enseignement d’une discipline, ne semble pas effleurer la Cour des comptes, de même que le principe même d’horaires d’enseignement obligatoires et d’égalité républicaine devant l’éducation. La Cour s’attarde assez peu en revanche sur le fait que, pour des raisons économiques, les établissements scolaires ‒ avec des dotations minimales ‒ ne peuvent d’ores et déjà appliquer que les horaires planchers par exemple en français.
Non, il faut « adapter les rythmes d’apprentissages » aux élèves, ce qui suppose de non seulement mettre un terme au principe de l’emploi du temps hebdomadaire, mais au principe même de classe qui imprimerait un rythme d’apprentissage. D’ailleurs la Cour va plus loin encore : il ne s’agit pas seulement d’adapter les emplois du temps mais « les contenus » même des programmes !
La flexibilité tous azimuts (horaires, classe, emploi du temps, contenus des programmes) est bien évidemment dans l’intérêt de l’élève. Elle permettrait en réalité de résoudre les difficultés de remplacement des absences « afférentes au cadre hebdomadaire » (p. 37).
Le - gravissime - problème de l’absentéisme des enseignants
Si la question de la continuité pédagogique effleure peu la Cour des comptes, en revanche celle de la présence des enseignants devant les élèves la préoccupe gravement. Le vrai problème de l’éducation nationale, ce sont bien les absences des enseignants, n’en doutons pas !
On voit pourtant mal en quoi un emploi du temps non plus annuel mais hebdomadaire (c’est-à-dire mis en place une semaine à l’avance au moins) résoudrait les absences de courte durée (un tiers du temps des absences), évoquées longuement par la médiatrice de l’Éducation nationale, laquelle reconnaît d’ailleurs qu’il s’agit d’un faux problème. Selon « Le Figaro » en effet « les quelques chiffres disponibles ne présentent pas, si l'on excepte les congés maternité, nombreux dans un métier largement féminisé, le tableau d'une profession plus absentéiste que les autres: entre 3,4 et 5,8% de professeurs absents sur un jour donné, pour une moyenne nationale de 4,5% des salariés. »21
Pourtant, avec son amabilité coutumière la Cour des comptes met en doute les chiffres sur l’absentéisme des enseignants, et ce pour bien entendu les majorer en se fondant au doigt mouillé sur la « perception » des familles (p. 39). Le sympathique graphique proposé p. 38 par la Cour a la particularité de prouver qu’il y a en permanence entre 50.000 et 100.000 enseignants absents… même en période de vacances scolaires ! Les absences de courte durée deviennent d’ailleurs, dans ce graphique, des absences hebdomadaires.
La naïveté de la proposition de la Cour est presque touchante : il s’agit tout simplement de contraindre les enseignants présents à remplacer au pied levé leurs collègues absents. Une telle proposition suppose évidemment que des professeurs soient disponibles et présents dans l’établissement aux mêmes heures que le professeur absent, par définition de manière imprévisible pour les absences de courte durée, ce qui malheureusement relève tout simplement de l’impossibilité technique, et ce même en permettant aux remplacements de s’effectuer dans d’autres disciplines (on comprend mieux à ce sujet le relativisme de la Cour s’agissant des heures hebdomadaires obligatoires dans chaque discipline : les « besoins des élèves » et les « rythmes d’apprentissages » deviennent soudainement secondaires). Bien entendu, en astreignant les enseignants à une présence plus importante dans l’établissement, on augmenterait les chances de voir ces remplacements en partie effectués.
Autre considération naïve : « Les enseignants affectés au remplacement ont le même service hebdomadaire que les autres enseignants. Ils ne sont donc pas assez nombreux lors des pics d’absence pour assurer tous les remplacements, mais peuvent à l’inverse être inoccupés, au moins en partie, à d’autres périodes de l’année » (p. 38). Il faut d’abord rappeler qu’en raison des postes non pourvus chaque année les professeurs remplaçants effectuent désormais pour l’essentiel des remplacements de longue durée, comme le reconnaît d’ailleurs la Cour des comptes. Mais surtout, dans l’esprit de la Cour des comptes, un temps de service annualisé permettrait de faire face aux variations saisonnières des absences : un professeur certifié pourrait donc ‒ dans une logique comptable imparable ‒ enseigner le double de son temps de service en période de pic saisonnier des absences, avec un service de 36 heures de cours (en supposant que les professeurs remplacés aient des emplois du temps parfaitement complémentaires)…
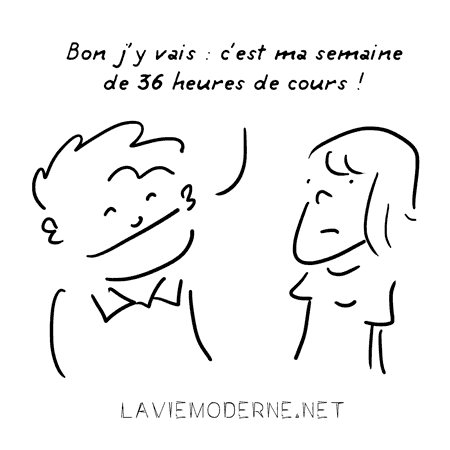
La Cour regrette par ailleurs que les professeurs acceptant d’effectuer des remplacements soient payés en heures supplémentaires (des « remplacements coûteux » p. 38). L’exemple de l’annualisation du temps de service en Allemagne (p. 39) ne laisse pas d’interroger : 3 heures mensuelles prévues dans le service pour le remplacement et, pour certains enseignants choisis par le chef d’établissement, deux heures de cours par semaine réservées au remplacement, payées en fin d’année selon qu’elles ont été effectuées ou pas. Bref un salaire variable, selon les absences des collègues et les possibilités de remplacement, et versé au dernier moment.
Pour le dire autrement, ce n’est plus au système éducatif de financer les remplacements : c’est à l’enseignant de compenser par ses variations de salaire les absences de ses collègues. Il est vrai que, à titre de compensation, les salaires des enseignants allemands ne sont guère comparables à ceux des enseignants français, mais la Cour n’évoque guère ce point.
De l’instruction publique à l’éducation territoriale
Il s’agit en effet de mettre un terme à l’Éducation nationale, ce vieux concept poussiéreux et dépassé.
La fin des concours nationaux
Pointée du doigt comme une autre des raisons de la mauvaise gestion supposée des enseignants : le caractère national de son recrutement dans le second degré, dont la Cour ne rappelle pas les vertus dans un pays aussi grand que la France. Des professeurs recrutés et affectés nationalement permettent un traitement égal des académies. Si certaines sont déficitaires, c’est tout simplement que de nombreux postes ne sont plus pourvus aux concours et que certaines académies sont plus difficiles par leurs conditions d’enseignement (éloignement, publics scolaires difficiles) et donc moins demandées que d’autres.
A dire vrai le système d’affectation en France est l’un des systèmes les plus contraignants pour les enseignants, ce qui explique d’ailleurs en partie la crise de recrutement : les professeurs néo-titulaires ont en effet toutes les chances d’être affectés prioritairement dans des académies déficitaires qui ne correspondent pas à leurs vœux. L’ancienneté elle-même n’empêche pas une mutation à l’aveugle à l’intérieur d’une académie, depuis la mise en place en 1998 de la gestion déconcentrée en deux temps (inter et intra-académique).
A cette occasion la Cour n’effectue pourtant aucune comparaison internationale : il est vrai que certaines régions françaises sont plus grandes que les Pays-Bas, ou que 95% des habitants de l’Ontario résident dans une seule et même province, quatre fois plus petite que la France. En Allemagne le recrutement se fait par Länder. Le caractère national de l'affectation est bien une spécificité française, dans un esprit très républicain.
Voilà qui n’empêche pas la Cour de critiquer vertement le principe même des affectations individuelles (p. 54), sans doute pour renforcer encore l’attractivité du métier.
Dans la logique d’un recrutement local par le chef d’établissement, sur le modèle du privé (voir plus haut), la Cour préconise dans le second degré un recrutement académique sur le modèle du premier degré, même si dans la pratique un tel recrutement ne résout pas le problème des académies déficitaires (p. 92) et crée des inégalités de recrutement entre les académies. Un tel recrutement aura le mérite de faire disparaître ces inégalités trop visibles puisque actuellement 55% des néo-titulaires sont affectés dans les académies de Créteil, Versailles, Lille et Amiens, et de faire disparaître le taux de renouvellement (de 84,6% entre 1999 et 2006 à Versailles).
Il s’agit en fait – sans le reconnaître – de rendre le concours plus accessible dans les académies déficitaires. Les seuils d’admission au concours du CRPE dans les académies déficitaires, qui restent pour autant chroniquement déficitaires, en témoignent déjà dans le premier degré.
La territorialisation de la gestion des enseignants
« Plus récemment, la réforme de l’administration territoriale de l’État (REATE) a eu pour objectif à la fois d’améliorer le service rendu au public, en regroupant les services et en rassemblant les compétences, et de recentrer les services de l’État sur les missions prioritaires » (p. 62).
La « gestion des enseignants » ne serait donc plus une « mission prioritaire » de l’État ?
La Cour des comptes devrait pourtant s’interroger sur les conséquences économiques de la décentralisation dans l’Éducation nationale, lorsque sont notamment confiées aux collectivités locales des missions qui ressortissent à la pédagogie : la gabegie numérique en est l’aspect le plus frappant.
En tout cas, c’est bien au nom d’une amélioration du « service rendu » que la Cour propose de territorialiser la gestion des ressources humaines afin que les gestionnaires puissent mieux prendre en compte « le contexte de l’établissement » (p. 126) : « Susciter, développer et entretenir la qualité de cette ressource suppose une gestion adaptée et non pas uniquement une gestion de masse » (p. 99). Noble préoccupation, qui suppose donc que la « personnalisation insuffisante » (p. 66) n’est pas liée à un nombre de gestionnaires insuffisant : la Cour reconnaît pourtant que les agents de gestion sont bien plus nombreux dans les autres ministères (et même plus de deux fois plus nombreux dans le secteur privé). Avec un agent seulement pour 143 personnels dans l’Éducation nationale, la Cour des comptes – comme elle l’avait fait pour les inspections pédagogiques trop peu nombreuses – n’en conclut pas à une gestion à l’économie, mais à une gestion inefficace :
« Le taux d’encadrement du ministère de l’éducation nationale pourrait témoigner d’une efficience bien supérieure à celle des autres administrations. En réalité, il est surtout le signe d’une personnalisation insuffisante de la gestion des ressources humaines. » (p. 66)
Sans craindre de se contredire d’ailleurs elle réclame par ailleurs que la gestion des enseignants devienne collective (p. 51). De même elle déplore la non uniformité des moyens accordés aux établissements ECLAIR tout en réclamant par ailleurs d’adapter les ressources aux situations locales.
Nul doute bien sûr que, dans le cadre d’une gestion territorialisée, la répartition des moyens deviendra plus sûre. On peut déjà constater que la décentralisation, confiant la gestion des établissements scolaires aux collectivités locales dont les richesses sont très différentes, est une source d’inégalités criantes entre les académies.
L’obsession du « pilotage »
Précisément la Cour considère que « les modèles d’allocation des moyens, dans le premier comme dans le second degré, reposent sur des critères largement inadaptés aux objectifs du système éducatif » (p. 69). À ses yeux taux de bénéficiaires des minima sociaux, pourcentages des professions et catégories sociales défavorisées, pourcentages de chômeur etc. constituent des critères « approximatifs » : avec un sens déroutant de la statistique, la Cour affirme ainsi doctement qu’« un élève de milieu défavorisé peut avoir de bons résultats et des établissements aux résultats satisfaisants peuvent accueillir des élèves rencontrant des difficultés d’apprentissage » (p. 69).
Tout aussi savamment la Cour explique, sans citer aucune source à l’appui, que « la carte de l’échec scolaire ne coïncide pas avec celle des difficultés économiques et sociales » : ce serait donc un message d’espoir pour l’école, qui lutterait efficacement – à en croire la Cour – contre les inégalités sociales. Il est dommage que la Cour ne communique pas dans ses documents annexes la carte de l’échec scolaire, pour rendre service au Ministère de l’Éducation nationale.
Pour déterminer enfin les « besoins des élèves », que les enseignants ne sont bien entendu pas à même de connaître, la Cour regrette qu’il n’y ait pas de tests de compétences passés par les élèves « en début d’année scolaire » (p. 67). En suivant le raisonnement de la Cour, c’est donc après la rentrée scolaire et la remontée des tests de compétences qu’il faut affecter les moyens aux établissements. Il est vrai que les emplois du temps hebdomadaires devenant flottants (voir plus haut), il n’est plus nécessaire de connaître à l’avance les difficultés des élèves et la rentrée scolaire peut de façon très efficace laisser place à des examens tous azimuts.
La rationalisation agressive de l’offre éducative
La Cour des comptes critique également l’offre de formation au lycée « dont l’éparpillement est coûteux » (p. 110) « dû à un nombre important de matières, d’options et de modules proposés à des groupes d’élèves nécessairement en petit nombre, ce qui explique son coût élevé en ressource enseignants » (p. 111). La dotation supérieure de l’enseignement professionnel (en professeurs spécialisés, en locaux, en matériel) semble en effet insupportable.
Répondre aux « besoins des élèves » devient soudain très secondaire, ce qui n’empêche pas la Cour de conclure avec un certain cynisme : « Les besoins des élèves doivent être au fondement du pilotage de l’ensemble du système » (p. 138).
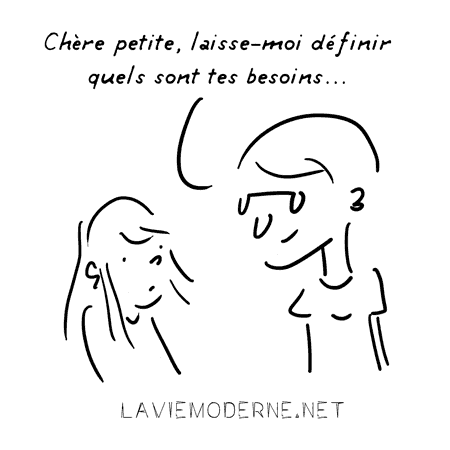
Il est également question, dans la logique de la territorialisation, d’adapter les formations aux besoins des bassins. Les besoins des élèves n’ont plus qu’à s’adapter à ces derniers ainsi qu’à la gestion prévisionnelle quinquennale que la Cour recommande.
Une forte coloration idéologique
Finalement le plus surprenant dans ce rapport est combien la Cour des comptes sort largement de son champ de réflexion (la « gestion des enseignants ») et plus radicalement encore de son champ de compétence (l’économie) pour investir – de façon très libre et décomplexée – celui de la pédagogie.
Toujours plus de “nouvelles pédagogies”
Malgré quelques précautions oratoires22, la Cour semble en effet avoir, sur les questions pédagogiques, quelques opinions bien arrêtées : s’appuyant sur les « réformes pédagogiques récentes » elle prône ainsi plus ou moins explicitement la « dimension collective de l’exercice du métier d’enseignant » (p. 52), le travail en équipe, l’interdisciplinarité, la pédagogie de projet, la disparition de l’autorité professorale, le renoncement à la transmission disciplinaire, la personnalisation de l’enseignement, l'instauration des cycles, l’évaluation pédagogique par le chef d’établissement etc. Il est vrai que, dans un précédent rapport de 2010, la Cour avait préconisé la suppression du redoublement, déjà bien entendu pour des raisons déjà « pédagogiques ».
Dans l’ensemble sa volonté de se fonder uniquement sur les « besoins des élèves » (l’expression est employée rien moins qu’à 43 reprises dans le rapport comme une sorte d’ultima ratio) n’est que l’expression renouvelée de l’idéologie de l’élève au centre du système. La Cour revendique des réformes « au bénéfice de la jeunesse » (p. 142) : qui pourrait s’y opposer ?
À la vérité ces “nouvelles pédagogies” ne sont plus si nouvelles puisque elles sont entrées massivement dans l’école depuis 1989, avec la création des IUFM avec ses cohortes de formateurs très orientés et d’experts en sciences de l’éducation prenant en charge les stagiaires jusqu'à leur titularisation, puis la mise en place des nouveaux programmes (1991 à l’école primaire, 1996 au collège, 2000 au lycée), la réforme du lycée professionnel et du lycée général en 2010 etc. L’« efficacité » et l’« efficience » de toutes ces réformes ne sont curieusement pas mises en cause par la Cour des comptes qui – bien au contraire – exige encore, tel Moloch, de nouvelles réformes du statut des enseignants au nom des mêmes nouvelles pédagogies.
Nulle part le rapport la Cour n’établit de relation entre la baisse dramatique des horaires de français dans le premier et le second degré23, dont les nouvelles pédagogies sont responsables, et la baisse des résultats en compréhension de l’écrit des élèves.
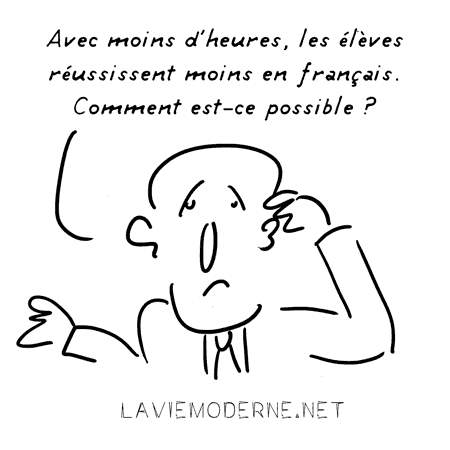
Comment se fait-il que dans une école où la pédagogie a été à ce point rénovée et les moyens de formation à ce point développés les résultats français déclinent ? La Cour des comptes ne s’interroge pas sur ce point. Pour la Cour, les réformes, dont les résultats ne sont pas évalués, constituent toutes des modèles à suivre, comme par exemple les itinéraires de découverte au collège ou l'accompagnement personnalisé ou les TPE au lycée.
En revanche, constatant les médiocres résultats en lecture ou en mathématiques, en baisse dans les enquêtes internationales, la Cour des comptes proclame que la « gestion des enseignants » est le seul « levier » sur lequel il est possible d’agir. Et à cet effet, comme on a pu le voir, la Cour n’est pas à quelques approximations près.
C’est ainsi que les nouvelles pédagogies sont convoquées une à une, tel un chapelet, dans le rapport de la Cour des comptes, du moins quand elles sont utiles (de même que les comparaison internationales), à tel point que le rapport s’apparente bien souvent à un bêtisier des “nouvelles pédagogies” constructivistes. Bien sûr, lorsqu’il s’agit de réduire l’offre de formation ou de personnaliser l’enseignement avec un taux d’encadrement le plus faible de l’OCDE, la Cour jette un voile pudique sur les « besoins des élèves ».
Le but de cette coloration idéologique est simple : justifier par une supposée modernité éducative des atteintes au métier d’enseignant permettant de réaliser plus encore d’économies : « Les recommandations exposées ci-après visent à atteindre les objectifs d’amélioration de la gestion des personnels enseignants pour un système éducatif plus performant, c’est-à-dire plus efficient et mieux adapté à l’objectif de réussite de tous les élèves » (p. 140).
La réussite pour tous… mais quelle réussite ?
Dans son introduction (p. 9-10), la Cour définit la mission de l’école :
« Responsable de la formation de plus de douze millions d’élèves de la maternelle au lycée, l’école a pour mission de garantir la réussite de tous les élèves » et rappelle le code de l’éducation qui définit cette réussite : « socle commun de compétences et de connaissances à l’issue de la scolarité obligatoire », « qualification reconnue » et « égalité des chances ».
C’est ainsi quasi-officiel : la scolarité obligatoire est désormais obligatoire jusqu’à 18 ans. Dans un autre rapport publié le 14 septembre 2012, la Cour recommandait de repousser l'orientation des élèves en seconde, « en fin de scolarité obligatoire ». Après le collège unique, voici venir le lycée pour tous (et même le lycée unique puisque la Cour souhaite pousser davantage d'élèves vers l'enseignement général), devenu une réalité puisqu’en 2012 85% d’une génération atteignait le niveau Terminale, conformément aux objectifs fixés à l’école dans les années 80, et qu’en vingt-cinq ans, de 1987 à 2012, le pourcentage d’une génération obtenant le Bac a plus que doublé, passant de 32,6% à 76,7%24. Ce qui n’empêche pas la Cour de tonner contre l’augmentation de la dépense éducative en France dans la même période et contre l’échec de l’école malgré une telle « réussite ».
La Cour n’interroge pas cette contradiction entre les résultats de plus en plus spectaculaires au Baccalauréat (avec le doublement du nombre de bacheliers ou l’inflation prodigieuse des mentions depuis dix ans25), et les résultats médiocres dans les évaluations internationales (« la performance du système éducatif français se dégrade » p. 135). Il est pourtant facile d’y voir une forme de démagogie politique destinée à masquer le naufrage de l’école par une complaisance coupable généralisée au moment des examens26.
Si la réussite est liée à l’obtention d’une « qualification reconnue », la mission de l’école n’est-elle pas pleinement accomplie ? Le socle commun, belle coquille vide, est validé pour tous les élèves ou presque à l’issue du collège. Plus de 90% des élèves obtiennent le Bac ou d’autres diplômes, comme le CAP ou le BEP. Bien sûr, des élèves continuent à quitter le système éducatif sans diplôme, mais ils sont chaque année moins nombreux. En revanche la Cour ne met pas en cause certaines filières professionnelles (secrétariat, comptabilité par exemple) qui ne sont pas professionnalisantes mais permettent utilement de scolariser de nombreux élèves jusqu’au Bac.
Rappelons au passage que le baccalauréat est le passeport pour des études supérieures et d’ailleurs l’objectif politique de 50% d’une classe d’âge diplômés de l’enseignement supérieur a déjà été défini. Mais la Cour de comptes ne s’interroge pas sur le coût, le sens ainsi que sur l’échec d’une telle politique : trois étudiants sur dix quittent l’université à la fin de la première année, et seulement 27% des étudiants parviennent à terminer leur licence en trois ans27. En Finlande, pays souvent donné en modèle par ses excellents résultats à PISA et dont la dépense éducative est très supérieure à la nôtre (6,8% du PIB en 2009 contre 5,9% en France), la scolarité commence à six ou sept ans, les lycées sélectionnent les élèves à la sortie de l’école fondamentale, à seize ans, et moins d’un tiers des bacheliers sont admis à l’université.
L’égalité des chances dévoyée
On voit bien que le problème n’est pas dans la « réussite de tous » mais dans ce qu’on entend par « réussite ». À ce sujet la Cour reste évasive tout en postulant que cette réussite n’est pas liée à un niveau minimal ou à un diplôme.
Peu importe. L’objectif de la « réussite de tous », devenue une « exigence » (p. 141), corrobore le glissement sémantique qu’a connu l’expression « égalité des chances » : il ne s’agit non plus qu’un élève puisse réussir quels que soient son origine ou son milieu social, mais que tous les élèves réussissent à égalité. Non plus une égalité de traitement pendant la scolarité mais une égalité de réussite de tous les élèves en fin de scolarité, ce qui ne peut que laisser dubitatif, surtout quand la réussite procède d’une telle mise en scène, façon village Potemkine.
Le beau concept d’égalité des chances est en effet devenu un slogan soviétique destiné à masquer, au cœur de cette réussite apparente, des inégalités de plus en plus criantes que font entrevoir par exemple les comparaisons internationales. Un slogan contre lequel personne ne peut s’élever bien sûr, car qui pourrait vouloir s’opposer à l'égalité des chances sans passer pour un dangereux réactionnaire ?
La « réussite de tous les élèves », quand elle est artificielle, est une terrible et insidieuse idéologie, qui corrompt l’esprit même de l’école et constitue, parmi d'autres, une cause profonde de son échec. La réussite devient en effet une sorte de droit auquel chacun peut prétendre et que chacun peut réclamer. La validation automatique des examens, la suppression presque totale du redoublement ou bientôt des notes et l’orientation choisie en sont des exemples saisissants.
Pour sauver l’école il faut revenir à une réussite moins ambitieuse mais plus honnête de tous les élèves et revenir à une égalité des chances qui ne soit pas illusoire : « la réussite de tous les élèves » est un « facteur déterminant de la cohésion sociale et de la compétitivité de notre pays » (p. 135) affirme la Cour des comptes, qui trahit ainsi sa vision utilitariste et néo-libérale de l’école : acheter la paix sociale et veiller à l’employabilité des futurs travailleurs. Mais même dans cette triste perspective, tout porte à croire que cette idéologie qui renonce à donner aux élèves les compétences et la culture auxquelles ils ont droit tout en leur promettant la réussite de tous, est au contraire une effroyable source de frustration et d’inégalités.
Les vraies motivations de la Cour des comptes apparaissent notamment dans les comparaisons avec l’Allemagne ou les Pays-Bas, dont les résultats sont en réalité comparables à ceux de la France : son but n’est pas d’améliorer la « performance » scolaire de la France mais d’en réduire encore le coût, supposé trop élevé.
Jamais dans son rapport la Cour des comptes ne remet en cause les dogmes actuels : le lycée pour tous et la réussite de tous les élèves, la folle stratégie numérique ou les ravages des nouvelles pédagogies. Toutes choses qui coûtent bien plus cher à l’Éducation nationale que la « gestion des enseignants », et pas seulement d’un point de vue économique.
Le mépris du métier d’enseigner
Plus grave encore que sa partialité idéologique, ce rapport exprime surtout à l’égard des enseignants un véritable et profond mépris. On y cherchera en vain le moindre signe de bienveillance ou de gratitude à l’égard d’enseignants dont les conditions de travail et de rémunération se sont pourtant fortement dégradées depuis plusieurs décennies28.
Bien au contraire : aimablement la Cour égrène les chiffres bruts et accablants : le nombre d’enseignants, le « poids » (p. 9) que représentent leurs rémunérations, la part de l’éducation dans le budget général de l’État : « Les 837 000 enseignants constituent près de la moitié des fonctionnaires de l’État. Le budget de masse salariale associé à ces emplois atteint 49,9 Md€ en 2011, soit 17 % du budget de l’État. » (p. 135)
« Gérer les enseignants autrement », tel est l’intitulé du rapport. La Cour a beau parler ensuite de « richesse humaine » (p. 99) et critiquer sa « gestion de masse » (p. 61), les enseignants sont bel et bien traités comme des choses, comme on gère un domaine, un commerce, une entreprise ou un budget. Mais qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas d’une simple maladresse lexicale, mais d’appliquer dans l’Éducation nationale les méthodes du management moderne, en démantelant méthodiquement le statut des enseignants.
« La définition des missions attendues des enseignants, la répartition des postes entre les établissements, la façon dont les affectations sont décidées, le soutien dont ceux-ci bénéficient tout au long de leur carrière comme leur niveau de rémunération ou leur temps de travail, sont autant de leviers aux mains des pouvoirs publics. En outre, l’adaptation de la gestion des ressources enseignantes (évolution du temps de service, élargissement des missions, création de primes ou mise en place de formations d’accompagnement) est unpréalable à la mise en œuvre de la quasi-totalité des évolutions de l’organisation pédagogique (modification des programmes nationaux, adaptation des rythmes scolaires, refonte des filières d’enseignement, mise en place de modes d’accompagnement individualisé, etc.). » (p. 12)
Les préjugés au comptoir
Toutes les considérations de la Cour des comptes sur les enseignants témoignent, lorsqu’on les réunit, d’une sympathique suspicion généralisée à leur égard.
« En matière de définition du service, les enseignants du second degré n’ont qu’une obligation de cours dans une discipline donnée » (p. 44)
La tournure restrictive de cette phrase est lourde de sous-entendus : combien d’enseignants, pourvus d’une véritable conscience professionnelle, travaillent réellement en dehors des cours ?
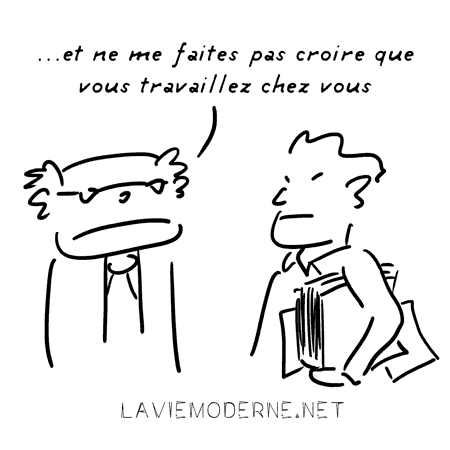
De même les professeurs sont soupçonnés d’être plus absents que ne le déclare le Ministère (p. 39). La réalité du travail à l’occasion des heures supplémentaires d’enseignement (HSE) est mise en doute29, tout comme la réalité du temps de travail des enseignants à la semaine (enquête du ministère seulement « déclarative » et peu « fiable » p. 101) ou à l’année, en raison des examens en juin (« la réalité des modulations de l’année, en fonction de la préparation et du déroulement des examens par exemple » p. 105). Nombre de professeurs sont accusés d’être en sous-service (p. 36), comme s’ils en étaient responsables, mais la Cour n’indique pas combien de professeurs travaillent sur plusieurs établissements. Les TZR sont accusés d’être « inoccupés » une partie du temps (p. 38). La présence des enseignants à des formations ou leur participation à des jurys d’examen est considérée comme une forme d’absentéisme.
L’indemnité ISOE est versée à tous les professeurs « quelle que soit la réalité de leur implication dans ces domaines » et « alors que ces tâches font partie intégrante des missions des enseignants » (p. 31). De même les indemnités pour la participation aux jurys d’examens nationaux) qui rémunèrent des tâches déjà incluses à ses yeux dans les missions des enseignants alors que « l’enseignant est déjà déchargé de cours » (p. 31). Sans doute la Cour ignore-t-elle que, entre surveillance, participations aux diverses réunions, secrétariat et examens eux-mêmes (session d’oraux à préparer et à faire passer et/ou correction d’écrits), les professeurs peuvent doubler leur temps de travail en période d’examen, ou que les professeurs qui corrigent le Brevet des collèges perçoivent la faramineuse indemnité d’une vingtaine d’euros.
Il est vrai que plus de neuf personnes sur dix rencontrées ou auditionnées par la Cour des comptes à l’occasion de ce rapport sur les enseignants n’enseignaient pas dans le public.
D’une manière générale la Cour fustige toutes indemnités ou décharges de service (p. 29-30), conçues comme indues. On trouve même dans le rapport certaines contre-vérités30, comme par exemple l’heure de première chaire au lycée qui serait « accordée à tout enseignant exerçant en classe de première ou de terminale » (p. 29).
Si la Cour des comptes concède du bout des lèvres que les enseignants sont mal payés, elle ne peut s’empêcher de relativiser cet état de fait (voir plus haut) ou d’y glisser une perfide :
« La moyenne des rémunérations de la profession, facteur essentiel d’attractivité à long terme, est plus basse que celle des autres cadres de la fonction publique, y compris après correction des différences estimées de temps de travail sur une base, il est vrai, déclarative. Elle l’est aussi par rapport à la moyenne des enseignants des pays membres de l’OCDE. » (p. 133)
Elle ne propose bien sûr aucune recommandation au sujet de ces rémunérations basses. En revanche la Cour détaille longuement et avec délectation certaines rémunérations extravagantes, sans doute pour promouvoir encore la haute considération des enseignants dans l’opinion publique. Concernant les rémunérations, la Cour exprime son aversion du principe de l’ancienneté et laisse entendre que le mérite n’y prend aucune part.
Enfin, à mots couverts, la Cour remet même en question ici ou là la conscience sociale des enseignants : « De façon générale, une répartition uniforme des créations ou des suppressions de postes, mieux acceptée localement, est privilégiée. Cette pratique ne permet pas de réajuster les moyens aux besoins » (p. 72).
Mais – et voilà le cynisme – c’est bien entendu dans l’intérêt des enseignants eux-mêmes que la Cour des comptes propose toutes ses recommandations car il s’agit bien de « valoriser les compétences d’un personnel de cadres et de cadres supérieurs » (p. 132-133) : il s’agit de répondre « aux attentes des enseignants ».
Curieusement la Cour n’évoque pas ces (nombreux) professeurs qui par exemple assurent la maintenance quotidienne du matériel informatique ou organisent/accompagnent bénévolement et sur leur temps libre des voyages scolaires : dans combien de professions accepterait-on de travailler 24h/24 pendant plusieurs jours, en endossant une responsabilité écrasante, le tout sans aucune contrepartie financière ?
La vocation d’enseignant, incompréhensible concept
La Cour des comptes s’interroge ingénument pour savoir ce qu’est un « bon enseignant » (p. 24), regrettant l’absence de « référentiel normatif », sur un mode tayloriste qui permettrait d’optimiser le travail et d’évaluer la performance des uns et des autres.
Or on comprend, à de nombreux indices du rapport, que le concept de vocation d’enseignant, avec ce qu’elle suppose d’engagement républicain, de conscience professionnelle, d’amour de la transmission et – pour le second degré – d’attachement profond à une ou plusieurs disciplines, échappe totalement à la Cour des comptes. Il y a d'ailleurs fort à parier que ce soient cet engagement et cette conscience professionnelle qui expliquent le manque de combattivité des enseignants, quand il s'agit de défendre leur profession, et par conséquent la saisissante dégradation de leur condition depuis plusieurs décennies.
La liberté pédagogique et le caractère profondément personnel – voire intellectuel – de ce métier, avec sa liberté d’organisation et de travail, sont ainsi assimilés par la Cour des comptes à un catastrophique « isolement de l’enseignant » (p. 185) auquel une gestion collective, embrigadée et annualisée doit pouvoir mettre un terme définitif. Jacques Muglioni nous avait pourtant averti :
« Il n’y a pas d’équipe pour penser. Le groupe et l’appartenance entraînent fatalement une régression intellectuelle. Avec l’équipe pédagogique, on cherche avant tout à dégrader, à dévaluer à ses propres yeux, le corps enseignant. » (La Gauche et l’école, L’École ou le loisir de penser, 1993).
Déplorant que la formation continue soit insuffisante, la Cour ajoute qu’elle est pour moitié consacrée dans le second degré aux « approches disciplinaires », ce qui constitue à ses yeux un mystère insondable. L’attachement à une (ou plusieurs) discipline est pourtant bien souvent l’idéal d’une carrière et même d’une vie : une discipline donne à l’enseignant sa valeur et sa fierté, mais aussi son indépendance.
La Cour des comptes déplore l’absence d’évolution de carrière pour des professeurs supposés vouloir devenir autre chose que professeurs ou du moins d’accéder à des responsabilités managériales vis-à-vis de leurs collègues. C’est ne pas comprendre qu’être professeur est bien souvent la vocation d’une carrière entière, et non un emploi en attendant mieux. Et que l'ambition que les enseignants n'ont pas pour eux, ils l'ont pour leurs élèves.
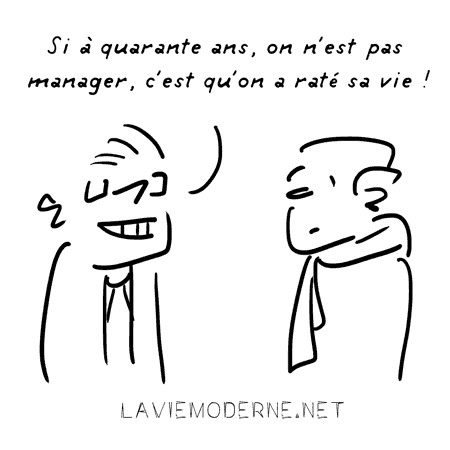
Il faut d’ailleurs aujourd’hui beaucoup de vocation pour avoir envie de devenir enseignant, ne serait-ce que parce que l’idée même de réussite scolaire a été corrompue par les nouvelles pédagogies.
Les enseignants au rapport
Que peut-on bien conclure ? Il s’agit d’un rapport uniquement à charge contre les enseignants.
Fustiger publiquement les errements supposés de leur « gestion », c’est vouloir faire oublier tout le reste pour livrer les enseignants à la vindicte publique, quand ces derniers permettent pourtant à la France de conserver tant bien que mal des résultats honorables dans les comparaisons internationales malgré des conditions d’enseignement fortement dégradées et un effort national en baisse drastique depuis dix ans.
Dans ces conditions comment la Cour des comptes ose-t-elle en appeler à « la pleine collaboration de la communauté éducative » ? Dans un lapsus assez révélateur, la Cour déclare d’ailleurs que « le temps de la réforme est un temps long qui exige la recherche d’un consensus minimum » (p. 141).
Mais le plus grave et le plus inquiétant, face à ce rapport aux préoccupations moins pédagogiques que libérales, ce sont les réactions qu’il a suscitées dans l’actuelle majorité au pouvoir, malgré l'attaque frontale contre sa politique de recrutement. « Le rapport de la Cour des comptes donne mille fois raison à notre politique » a déclaré Yves Durand, rapporteur PS de la loi sur la refondation de l'école à l'Assemblée, qui y relève « des pistes particulièrement intéressantes »31. Le Ministère a lui-même jugé ce rapport « globalement juste, mais sévère » et le Ministre, s'il conteste qu'il ait suffisamment de moyens, y a vu « des choses positives »32 sans préciser lesquelles.
D'ores et déjà le Ministère indique, dans sa réponse à la Cour des comptes33, que « les modalités de recrutement des enseignants ont été rénovées afin de mieux prendre en compte la dimension professionnelle du métier dans les compétences attendues », que « de nouveaux dispositifs vont venir renforcer la coopération au sein des équipes éducatives ». Par petites touches, comme l’extension des missions des enseignants dans le Code de l’éducation ce 8 juillet 2013, la mise en place d’un cycle d’enseignement entre le CM1 et la 6e par décret du 28 juillet 2013 ou l’ouverture de « discussions » à l’automne 2013 sur le statut des enseignants, les préconisations de la Cour des comptes commencent à prendre corps.
Les recommandations bien peu républicaines de la Cour des comptes, si l'on considère que l'École et la République ne font qu'un, ne sont pas de nature à améliorer les performances du système éducatif français ou à résoudre la crise de recrutement mais – bien au contraire – à les aggraver dans des proportions dramatiques.
Disons-le : si, dans un éclair de lucidité, la Cour des comptes évoque le « malaise enseignant » (p. 14), non seulement elle ne sait pas en analyser les causes profondes mais elle y contribue pleinement.
Cet article peut être téléchargé au format ePub.
Notes
[1] « Le Monde » du 22/05/13 : « Horaires, salaires : la Cour des comptes critique la gestion des enseignants » ; « Libération » : « Pour la Cour des comptes, les profs sont mal gérés » ; « La Tribune » : « La Cour des comptes veut moins d'enseignants, mais mieux payés » ; « Le Figaro » : « Éducation nationale : la charge de la Cour des comptes » ; « L’Express » : « La Cour des comptes critique la création de 60 000 postes dans l'Éducation nationale » ; « Mediapart » du 27/05/13: « La potion amère de la Cour des comptes »
[3] Banque mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/
[5] Regards sur l’éducation 2012 : « Quelle part des dépenses publiques est consacrée à l'éducation ? »
[7] La Banque mondiale, « Population âgée de 0 à 14 ans (% du total) »
[8] OCDE, « Gross domestic product (GDP) MetaData : GDP per head, US $, constant prices, constant PPPs, reference year 2005 »
[10] « Le Monde », « La France dernière de l'OCDE pour l'encadrement des élèves » (14/02/2011)
[11] Ministère de l'Éducation nationale, communiqué de presse (18/12/2007).
[12] « Le Monde » : « Plus de 80% d’une génération au niveau du Bac » (13/07/2012) et Ministère de l'Éducation nationale, « L'éducation en chiffres 2013 ».
[14] DEPP, « La réussite au baccalauréat » (2012) et « Evolution des effectifs enseignants » (2012). Les résultats de PISA 2012 paraîtront fin 2013.
[15] DEPP, « La durée de la scolarisation » (2012)
[16] Résumé du rapport, consultable en ligne : http://www.ccomptes.fr/Actualites/A-la-une/Gerer-les-enseignants-autrement
[18] Blog du « Monde », « L’éducation déchiffrée » : « Le salaire des enseignants français à la loupe » (24/01/13)
[19] Voir nos articles : « Piège à con(cour)s » et « Piège à con(cour)s (suite) ».
[20] Sur la base de l’enquête ministérielle « Enseigner en collège et lycée en 2008 » (2009): 18,4h d’enseignement hebdomadaire, 21,25h hors enseignement, sur la base de 36 semaines d’enseignement et temps de travail pendant les vacances compris.
[21] « Le Figaro » du 8 février 2011 : « Absentéisme des profs : la grogne des parents d'élèves ».
[22]> « la Cour ne se prononce que sur son champ de compétence, c’est-à-dire sur l’organisation et le fonctionnement de la gestion, son efficacité […] et son efficience » p. 17-18.
[23] « Sauver les lettres », « Comparaison des horaires en primaire et au collège ».
[24] INSEE, « Proportion de bacheliers dans une génération en 2011 » et Ministère de l'Éducation nationale, « L'éducation en chiffres 2013 ».
[25] « Depuis les années 2000, le nombre de bacheliers qui obtiennent plus de 16/20 au baccalauréat général est passé de 2% à 9% » selon « L’Express » du 5 juillet 2013 : « Résultats du bac 2013: la mention "très bien" est-elle toujours un signe d'excellence ? »
[26] Sur la dévitalisation méthodique du Baccalauréat, voir notre article : « Diplôme de bacotille » (20 juin 2012)
[27] Ministère de l’enseignement supérieur, « Parcours et réussite en licence et en master à l’université » (avril 2013)
[28] Pour en rire, notre article : « Qui veut être professeur ? » (16 décembre 2012)
[29] « Toutefois, ces heures supplémentaires sont censées rémunérer du temps, alors qu’elles sont, pour partie, utilisées de façon forfaitaire : dans la pratique, l’investissement particulier d’un enseignant peut être récompensé par une heure supplémentaire effective, indépendamment du temps réellement passé (de moins d’une heure à plusieurs heures) » p. 30
[30] Ministère de l'Éducation nationale , « Des décharges horaires plus justes et mieux adaptées pour les enseignants du second degré » (20 février 2007)
[31] « Le Nouvel Observateur » du 28 mai 2013 : « Rapport sur les profs : des "pistes intéressantes" pour le PS ».
[32] « Libération » du 22 mai 2013 : « Rapport de la Cour des comptes : Peillon y voit des « choses positives » »
[33] Ministère de l'Éducation nationale , « Rapport de la Cour des comptes : gérer les enseignants autrement » (22 mai 2013).