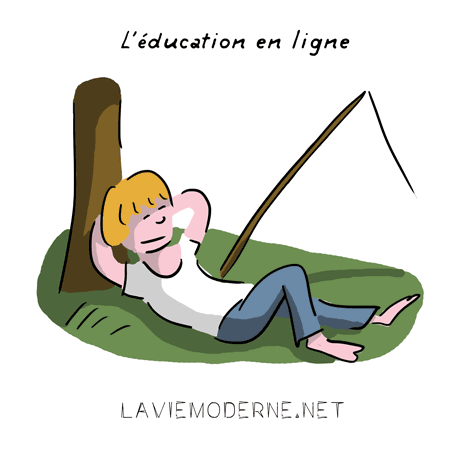Au pas de Coursera, l’université en ligne
Petite start-up deviendra grande. Ce qui n’était qu’un projet académique, Coursera, est devenu en à peine un an un business dynamique, d’envergure mondiale et à la croissance exponentielle. Mais qu'y a-t-il derrière cette success story à l’américaine ?
Les moocs, ces cours du futur, font rêver. Finis les vieilles universités aux murs défraîchis, les professeurs soporifiques, les amphithéâtres pleins à craquer et le vieux modèle « présentiel » : vive la modernité sur écran plat, l’université à haut débit et mondialisée, bref l’école enfin dématérialisée et ramenée à son essence de pur apprentissage.
La presse est à ce point dithyrambique avec ces pionniers du Far Web, cette révolution de l’enseignement, cette explosion des inscriptions, ce modèle d’excellence et en même temps de gratuité au service d’une démocratisation éducative à l’échelle du village global, que Coursera n’a guère besoin de publicité et se contente de recenser sur son site les articles les plus flatteurs.
Le pari des moocmakers
Que sont donc les moocs ? Nés aux États-Unis aux alentours de 2010, les moocs (massive online open courses) se définissent d’abord par leur public : sans restriction d’aucune sorte puisque ouverts à tous et sans limite physique puisqu’en ligne (même si matériel informatique et connexion Internet restent nécessaires), les moocs s’adressent à des publics d’une échelle jusqu’ici inconnue, un cours pouvant être suivi par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, voire davantage.
Les moocs se caractérisent ensuite par un enseignement entièrement dématérialisé, sans lieu physique ni relation humaine directe, à travers une plate-forme en ligne proposant des cours de niveau universitaire, fournis contre rémunération par les universités les plus prestigieuses, des vidéos et autres ressources pédagogiques, des forums de discussion, où les étudiants échangent et s’évaluent entre eux, et enfin des questionnaires en ligne : d’un point de vue technique, rien de bien révolutionnaire, en somme.
Les moocs présentent néanmoins une radicalisation de l’enseignement en ligne : le président de Stanford, John L. Hennessy, n’a-t-il pas prédit l’an passé la mort des salles de classe ? Il ne s’agit plus seulement d’apporter un complément aux cours dans les universités, mais – et malgré des dénégations prudentes – de les remplacer tout simplement, et cela avantageusement, bien entendu.
Reste à savoir à qui profitera cet avantage.

Dans le monde émergent et majoritairement américain des moocs, Coursera, créée à Stanford, Californie, a maintenant une nette longueur d’avance sur ses concurrents, même gratuits.
« Changer le monde »
Fondée en avril 2012 par Daphne Koller et Andrew Ng, deux professeurs en intelligence artificielle à Stanford, Coursera se présente comme une entreprise philanthropique destinée à « changer le monde ».
Daphne Koller, dont « Le Monde » a fait l’an passé un portrait élogieux, a « une dent contre l’école ». Esprit libertaire et frondeur (avec néanmoins un bon vieux doctorat et un poste à Stanford), elle rejette l’école dans sa forme traditionnelle, jugée obsolète, élitiste et autoritaire, avec ses programmes formatés et imposés aux élèves : sorte de Joan Baez du troisième millénaire, Daphne Koller réinventerait une école libre, gratuite et démocratique, à la porté de tous et répondant enfin aux seules aspirations de chacun. Il s’agit, selon ses propres mots, de « libérer l’enseignement » en offrant une « éducation de la plus haute qualité » au service d’« une vie meilleure ». L’entreprise de cette bienfaitrice de l’humanité serait presque caritative : « On peut découvrir des talents admirables n’importe où : peut-être que le prochain Albert Einstein ou le prochain Steve Jobs vit actuellement dans un village reculé d’Afrique ». La comparaison entre Albert Einstein et Steve Jobs en dit long sur une certaine conception du savoir, à mi-chemin entre génie scientifique et génie commercial.
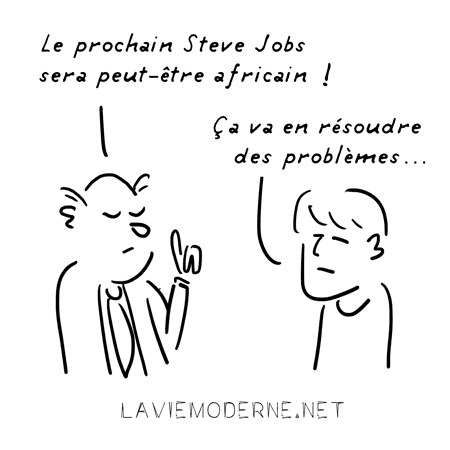
Dans ce nouvel idéal la transmission du savoir devient secondaire: il s’agit surtout de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences qui leur offriront de nouvelles opportunités professionnelles. Coursera se propose d’ailleurs d’adapter les cours aux besoins des entreprises, en passant des partenariats avec elles, et d’offrir à terme une plate-forme de recrutement servant d’interface entre employeurs et futurs employés. Le slogan de Coursera n’est-il pas « Advance your knowledge and career » ? L’exigence et la rigueur universitaires ainsi que le niveau à atteindre sont également secondaires : « De nos jours, il ne s’agit plus d’avoir la bonne réponse. Ce qu’il faut, c’est réfléchir ensemble et partager. »
Et bien sûr, cet idéal est généreux : Coursera revendique bruyamment sa gratuité à l’inscription. Mais il faut préciser que les certificats avec vérification d’identité sont payants. Daphne Koller est une femme d’affaires avisée, qui communique beaucoup plus sur la générosité de son projet que sur le business model de sa start-up.
Bref il s’agit moins de « libérer » l’enseignement que de le libéraliser.
L’éducation « augmentée »
Les moocs sont non seulement libres et démocratiques mais ils révolutionnent l’enseignement lui-même, avec des innovations pédagogiques revendiquées comme l’individualisation, la collaborativité ou l’évaluation par les pairs.
Les moocs permettraient ainsi ce que le cours traditionnel ne permet pas : la personnalisation de l’enseignement, cette vieille utopie des nouvelles pédagogies inspirée du préceptorat rousseauiste. « Nous devrions passer moins de temps dans les universités à faire la leçon à nos étudiants pour leur remplir l’esprit de connaissances et plus de temps à allumer en eux le feu de la créativité, de l’imagination et de la capacité à résoudre des problèmes en communiquant réellement avec eux ». Nul doute qu’un professeur, en ligne sur un forum avec des dizaines de milliers d’étudiant, pourra parfaitement personnaliser ses réponses et parler à chacun d’eux.
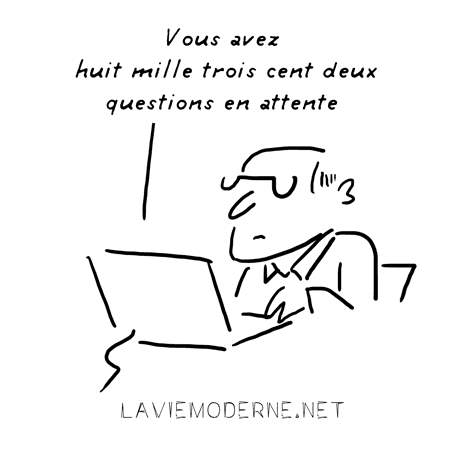
Les moocs permettraient également un enseignement choisi, source accrue de motivation pour les étudiants : les élèves n’auraient plus qu’à choisir les modules de cours qui leur plaisent et écarter ceux qui ne les intéressent pas. De même enfin, n’ayant plus d’horaires à respecter ou de lieux dans lesquels se rendre, ils choisiraient et organiseraient leur propre rythme de travail (ou presque puisqu’il faut malgré tout suivre une session de cours et de tests imposée). A vrai dire, passé l’enthousiasme de la nouveauté, on peut se demander si la motivation est vraiment au rendez-vous en l’absence de toute contrainte pour qui se retrouve seul face à un écran : pour des cours pourtant choisis sur la base du volontariat, on constate d’ores et déjà un taux d’abandon très élevé.
Par ailleurs, Daphne Koller, martyre de l’école, part du postulat qu’un cours traditionnel magistral est passif et source d’ennui. Peu importe si au contraire la prise de note est un acte de réflexion actif, nécessitant écoute, concentration, choix et reformulation, permettant une appropriation des connaissances. Il ne fait bien sûr aucun doute qu’un cours écrit ou enregistré en vidéo est moins magistral ou, même réduit à quelques minutes, moins ennuyeux.
Le principe de Coursera est fondé sur le concept à la mode de la flip-education qui renverse le modèle traditionnel : apprendre passivement chez soi, mettre en pratique activement à l’école. Seulement, avec Coursera, il n’y a pas d’école.
Bien sûr Coursera ne fournit aucune étude sur l’efficacité réelle de cette éducation « augmentée » dont on peut craindre en réalité qu’elle ne soit au rabais. Son seul succès est pour l’instant celui du nombre d’inscriptions puisqu’en un an Coursera a recruté presque trois millions d’« étudiants » à travers le monde. A titre de comparaison le premier mooc français n’a rassemblé à la fin de l’année 2012 qu’un petit millier de participants.
Le record de Coursera fait passer toutes les autres questions, même les plus légitimes, au second plan.
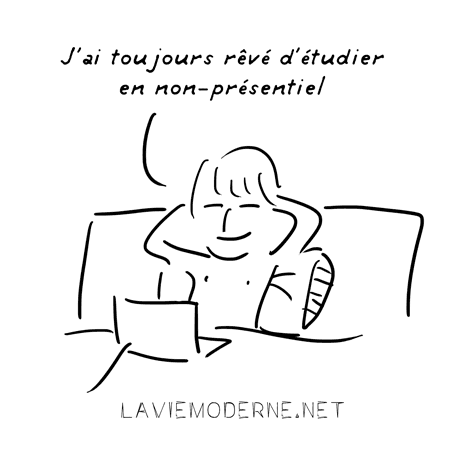
Demain on rase gratis
La « gratuité » revendiquée par Coursera fait d’autant plus rêver qu’elle offre un semblant de scolarité dans les universités les plus cotées et les plus coûteuses : il faut compter un quart de million de dollars pour suivre un cursus de quatre ans à l’université de Stanford.
Comme ses concurrents non commerciaux (edX) ou commerciaux (Udacity), Coursera se doit d’offrir une « gratuité » apparente. Or, malgré les déclarations philanthropiques de Daphne Koller, Coursera n’est pas une non-profit organization : c’est bel et bien une entreprise commerciale, à la recherche du profit, et si un fond de capital-risque a accepté d’investir seize millions de dollars dans Coursera en 2012, c’est dans l’attente évidente d’un retour sur investissement. Certes les profits ne sont pas encore au rendez-vous, comme pour Google à ses débuts, mais les investisseurs tablent déjà sur des services premium quand Coursera sera devenue incontournable sur le marché mondial de l’éducation en ligne. Ne pas oublier que Daphne Koller a eu une révélation au Google Education Summit.
Si les moocs peuvent offrir une éducation gratuite (ou presque), c’est parce qu’ils permettent de substantielles économies.
La dématérialisation est la première source de réduction des coûts : pas de campus, très peu de personnels (enseignement, secrétariat, intendance etc.) et une entreprise échappant en partie à la fiscalisation. A charge des étudiants de fournir leur propre local, matériel et connexion Internet. Les coûts de Coursera sont ceux de n’importe quel site web (hébergement, bande passante etc.) : les personnels recrutés par Coursera sont en majorité des ingénieurs informatiques. Curieux pour une entreprise d’éducation en ligne. Les cours mis à disposition par les universités doivent bien sûr être rémunérés mais, rediffusables en boucle, ils sont bien moins coûteux que les enseignants qui en sont les auteurs.
A titre d’exemple Daphne Koller s’oppose ainsi à l’enseignement en ligne tel que proposé par l’université de Phoenix : « Leur effort d’enseignement en ligne reste un enseignement vraiment traditionnel au moyen d’un ordinateur, et non un usage fondamentalement différent de la technologie. Il n’y a pas d’économie d’échelle ici. Ce que nous faisons, c’est un enseignant pour 50.000 étudiants. Voilà comment baisser le coût des cours. »
L’autre économie s’explique aussi par l’informatisation systématique : les inscriptions se font par formulaire en ligne, les cours ne nécessitent aucune organisation, les travaux complexes sont remplacées par de simples QCM automatisés etc. Il serait impossible d’employer les dizaines de milliers de professeurs nécessaires à la correction de millions de copies, comme le fait le CNED à une plus modeste échelle en France. La pensée complexe et personnelle, telle qu’on la rencontre dans un raisonnement mathématique, une traduction ou une dissertation, n’est plus évaluée.
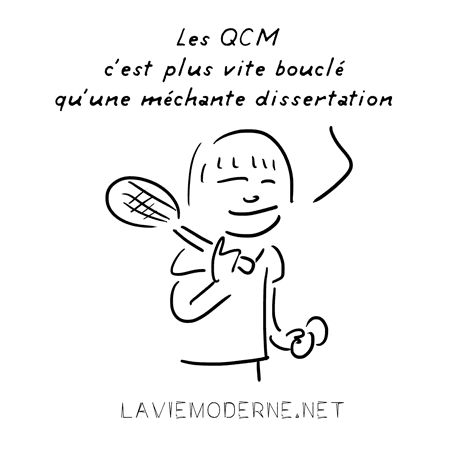
De même les démarches administratives sont simplifiées au maximum à l’inscription : aucune attestation, aucune vérification. Pour Coursera, une inscription universitaire n’est qu’un ajout dans une base de données. Devenir un « étudiant » de Coursera se fait en quelques clics : comme si une boutique comptait parmi ses clients tous les gens qui se sont attardés devant sa vitrine.
Les universités publiques, même gratuites, ne peuvent évidemment rivaliser en raison des frais d’inscription. Leurs examens sont pourtant gratuits, contrairement aux certifications payantes que propose Coursera, selon le modèle du freemium. Dans ces conditions, où est la vraie gratuité ?
Dernière source d’économie, avec la publicité gratuite offerte par les médias enthousiaste : la mise à contribution des étudiants eux-mêmes. Les cours enregistrés en anglais sont ainsi proposés à la traduction dans les autres langues aux étudiants étrangers sur la base du volontariat. De même certains projets complexes sont évalués non pas par des professeurs mais par des pairs, aboutissement de ce que l’on appelle la pairagogie, c’est-à-dire par les autres étudiants participant au cours.
On le voit : Coursera sait trouver une main d’œuvre bénévole, gratuite et enthousiaste, à défaut d’être qualifiée et rémunérée : la collaborativité sert en quelque sorte de green-washing à une recherche de réduction drastique des coûts dans la perspective d’un enseignement low-cost.
Un nouvel eldorado
Les économies d’échelle sont bien sûr permises par le caractère massif des moocs (sur le modèle économique des MMORPG, ces jeux en ligne gratuits qui offrent des options payantes et très lucratives) puisqu’il n’y a aucune limite physique à l’organisation de ces cours dématérialisés. Le marché potentiel de l’éducation en ligne à l’échelle de la planète s’évalue en dizaines et dizaines de millions de personnes, d’autant que ce marché peut s’étendre à la formation continue tout au long de la vie et à la mise en relation avec les entreprises. Dès lors il est nécessaire d’occuper le terrain et de prendre le plus de parts de marché possible pour prendre de court la concurrence : avec des centaines de milliers de nouveaux « étudiants » chaque mois, Coursera est désormais largement en tête dans cette nouvelle ruée vers l’or. Et tant pis si son modèle est encore expérimental et inachevé.
Le compteur du nombre de « courserians » inscrits, bien en évidence en haut de la page d’accueil du site, sert d’argument de vente. Tout comme le nombre croissant d’universités et d’écoles qui rejoignent le « projet ». Parmi eux, seize seront désormais hors des États-Unis et des cours seront bientôt dispensés dans quatre langues étrangères. Déjà neuf cours en français pour la rentrée de septembre 2013 et ce n’est qu’un début : les fondateurs de Coursera sont sans cesse en quête de nouveaux contenus à l’étranger. Quel intérêt de proposer des cours en italien ou en français sur un site américain hébergé par des serveurs américains, si ce n’est pour occuper le terrain et devancer les éventuelles initiatives nationales ?
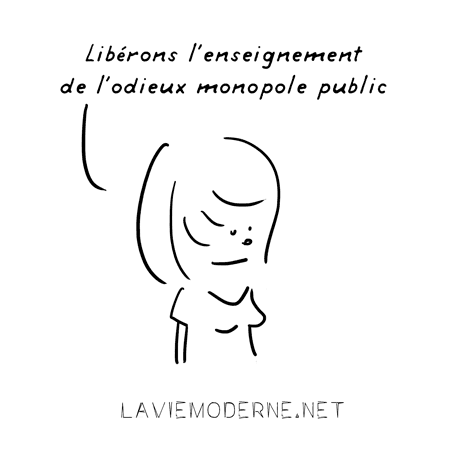
Pour séduire les étudiants à l’échelle planétaire, Coursera propose les cours donnés par les professeurs les plus réputés dans les universités les plus renommées. Appliquant à l’éducation les techniques commerciales du branding, Coursera crée sa propre notoriété en aspirant celle des autres, qu’elle affiche tel un tableau de chasse : Stanford, Princeton, Columbia, John Hopkins etc. Evidemment une telle pratique, sous l’apparence démocratique, légitime une forme d’élitisme universitaire puisque les écoles et universités moins réputés ne sont pas sollicitées. En France Coursera a démarché la prestigieuse École Polytechnique mais pas encore l’université de Paris-XIII Villetaneuse.
Une activité lucrative à terme
Peu importe si les étudiants qui paient les certificats avec vérification d’identité (à $79 la certification) ne représentent qu’une faible fraction de l’ensemble des inscrits. D’ores et déjà, sur trois millions d’étudiants revendiqués par Coursera, cette fraction reste importante, d’autant que les coûts de fonctionnement, passés les premiers investissements, sont réduits au minimum.
De plus, pour rentabiliser le modèle, d’autres services optionnels sont à l’étude, comme le tutorat ou d’autres moyens de soutien personnalisé (preuve s’il en est que le modèle en lui-même n’est pas personnalisé), des cours sponsorisés par des entreprises (comme en atteste le contrat signé avec l’université de Michigan), des cours au contraire sans publicité, des mises en relation entre des étudiants cherchant un emploi et des entreprises recherchant du personnel qualifié. Il est même question de faire payer les universités souhaitant offrir en complément l’accès à Coursera à leurs étudiants !
Même si les contrats passés avec les universités restent confidentiels, on sait qu’entre 6 et 15% seulement des revenus de Coursera seront reversés aux universités et 20% des bénéfices.
Comme dans la grande distribution, le vrai gagnant est bien Coursera.
Bien sûr, dans ce modèle d’enseignement, aucune royaltie n’est reversée aux professeurs, qui deviennent de simples producteurs de « contenus » pour les plus célèbres d’entre eux, dans un processus de starification (et de standardisation) de l’enseignement universitaire, les autres professeurs se contenant d’encadrer ou d’accompagner l’enseignement en ligne. Les conditions d’utilisation du site de Coursera rappellent bien que tous les contenus mis à disposition sont la propriété de Coursera ou de ses partenaires.
A terme, sa notoriété et son monopole étant mondialement établis, Coursera pourra évidemment renégocier à son avantage les revenus et bénéfices versés aux universités ou même proposer des cours de son propre cru, pour un coût quasi-nul.
L’absence de tout cursus
Le concept d’open courses ne laisse pas d’interroger.
D’abord parce que les cours de Coursera ne sont pas libres de droit (le progrès de la connaissance connaît tout de même quelques limites). Mais surtout parce que ces cours supposés ouverts à tous s’opposent à la conception même d’un cursus universitaire. Celui-ci implique en effet un niveau requis au départ, une cohérence disciplinaire entre différents cours et un parcours sur plusieurs années (de L1 à L3 par exemple) avec un niveau final, défini nationalement pour l’obtention d’un diplôme.
Chez Coursera, pas de cursus mais des modules regroupés par catégories. Pas de diplôme mais des certificats. Est considérée comme « étudiant » toute personne de plus de dix-huit ans inscrite non pas à un cursus d’études mais à un (ou plusieurs) modules de cours de quelques semaines, à raison de quelques heures par semaine.
On le voit : les « étudiants » des moocs n’ont pas grand-chose à voir avec les étudiants d’universités.
L’autre révolution pédagogique est qu’il n’est plus besoin d’attester d’un niveau requis pour accéder à un cours donné. Plus de sélection à l’entrée, qu’elle soit fondée sur la richesse ou sur le niveau scolaire, pour paradoxalement suivre les cours les plus sélectifs du monde : « Venez comme vous êtes ». L’exigence démocratique prime sur l’exigence pédagogique.
La plupart des cours proposés offrent d’ailleurs des fondamentaux ou des compétences immédiatement utiles, même en lettres (« Think Again: How to Reason and Argue » ou « English composition I », « Writing II : rhetorical composing »). Aucune progression n’est proposée ou presque, en tout cas qui soit comparable avec un cursus universitaire. Les cours sont comme déconnectés les uns des autres. Le modèle n’est pas celui du menu, mais du self-service et du fast-food.
Cette forme d’enseignement est bien dans l’air du temps pédagogique, comme en atteste dans le secondaire en France la mise en place du socle de compétences, de l’« accompagnement personnalisé » ou des « enseignements d’exploration » au détriment des cours classiques, avec les résultats brillants que l’on constate aujourd’hui.
Résultat de cette conception d’un savoir parcellisé et distribué sous forme de compétences immédiatement utiles, comme les bases de l’informatique ou du marketing : les disciplines plus intellectuelles et qui exigent mise à distance, approfondissement sur plusieurs années et offrant peu de débouchés professionnels directs sont largement sous-représentées dans les cours proposés par Coursera. A titre d’exemple, les matières « littéraires » (lettres, philosophie, anthropologie, psychologie, histoire etc.) sont regroupées dans une catégorie fourre-tout, les « humanities » qui ne représente qu’un sixième des cours proposés, soit autant que la « computer science » présentée, elle, dans quatre catégories distinctes !
Un tiers des catégories sont d’ailleurs liées aux seules nouvelles technologies, dans une mise en abîme vertigineuse.
Des certificats qui ne certifient… rien
Au-delà de l’évident problème éthique que pose la délivrance d’un certificat par une entreprise commerciale à ce qu’il faut bien appeler ses « clients », il est nécessaire d’étudier dans le détail en quoi consiste la certification proposée par Coursera. Cette question embarrassante est en effet considérée comme secondaire et rarement abordée, comme s’il suffisait – ainsi que le considère Michel Serres, par ailleurs professeur à Stanford – que le savoir fût disponible pour être acquis.
Rappelons ce qu’est un diplôme : un titre ou grade émané d’une université, d’une faculté, d’une société savante, d’un corps, d’une école publique, etc., pour attester les connaissances et les aptitudes de quelqu’un et qui est reconnu par les autres institutions.
L’an passé Daphne Koller s’est targué en août 2012 que 14.000 des « étudiants » de Coursera (sur 787.000 inscrits à la même époque) aient obtenu un « certificat officiel diplômant ». Même si ce nombre est ? dans l’absolu impressionnant ?, le taux de réussite n’est que d’un ordre de grandeur de 1 à 2% (contre environ 50% en moyenne dans les L1 de nos universités) : il faut croire que la motivation ne doit pas être si motivante que cela. La démocratisation est loin d’être en marche.
Mais surtout, en employant la curieuse expression de « certificat officiel diplômant », Daphne Koller entretient l’ambiguïté car il ne s’agit en aucun cas d’un diplôme. D’où l’expression équivoque de « certificat », lequel n’a par ailleurs rien d’officiel puisqu’il n’est reconnu nulle part et est délivré sans aucune garantie.
Bien entendu, c’est Coursera qui fixe elle-même le niveau attendu à la fin de chaque cours et les examens pour en attester : impossible dans ces conditions de comparer l’efficacité relative de l’enseignement en ligne de Coursera. De plus, même si le niveau attendu est élevé, les questionnaires reposent sur de simples questions à choix multiples, parfois en vrai/faux. Comme l’expérience le montre, il est possible de valider certains de ces questionnaires en répondant totalement au hasard.
Certains projets sont évalués, c’est-à-dire par les étudiants entre eux : il est facile d’imaginer quelles peuvent être les limites d’une telle évaluation.
Mais peu importe : comme dit Daphne Koller, « Je pense que si quelqu’un se présente et explique avoir suivi différents cours sur Coursera, les employeurs seront plus enclin à valoriser cette initiative. C’est la preuve d’un certain potentiel. ». Quelques mentions avec le nom d’universités prestigieuses sur un curriculum vitae : on voit – encore une fois – que ce n’est d’un niveau que les certificats de Coursera doivent témoigner, mais plutôt d’un état d’esprit ou d’un éventuel « potentiel ».
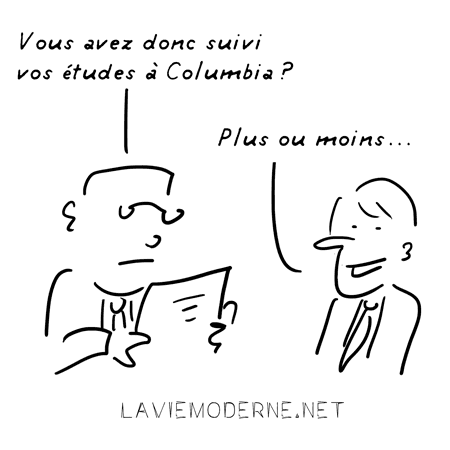
Les examens en ligne
La dématérialisation n’offre pas que des avantages car garantir en ligne et de façon automatisée qu’un étudiant a bien passé un examen est un véritable casse-tête technologique : de ce point de vue les bons vieux examens traditionnels ont leur vertu.
Pour les questionnaires, Coursera a entrepris d’offrir certaines garanties et vient seulement de mettre en place, en janvier 2013, un système payant de « signature track », avec vérification d’identité, permettant d’obtenir des crédits « Ace » (« American Council of Education »). Sur 325 cours proposés début mars 2013, 14 seulement permettent cette vérification d’identité, ce qui signifie que 95% des cours suivis offrent des certificats sans aucune valeur.
Mais le pire est que la certification elle-même n’offre aucune garantie : elle s’appuie en effet sur deux éléments d’identification à distance, la signature de frappe au clavier (une technique qui est loin d’être au point) et une photographie prise par une webcam. Cette certification implique d’abord qu’il faut payer avant de suivre les cours : l’option de certification n’est donc plus si optionnelle. Mais surtout il est facile d’imaginer comment contourner ces deux éléments d’identification, à l’aide par exemple d’une tierce personne experte dans la discipline étudiée. Mais à vrai dire on peut encore imaginer toutes sortes d’autres formes de fraude, aussi inventives et innovantes : la technologie lui ouvre en effet de nouveaux horizons.
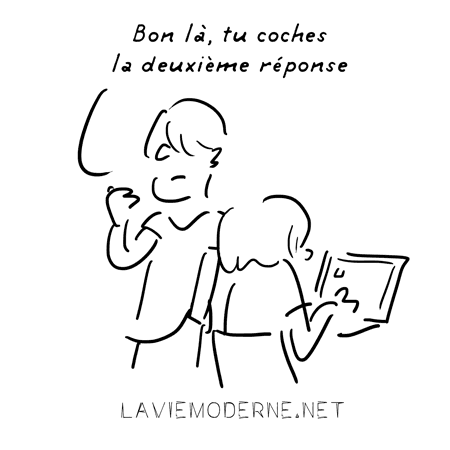
Heureusement, les étudiants qui s’inscrivent sur Coursera approuvent un « code d’honneur » et – de toute façon – Andrew Ng pense que la fraude n’est pas un problème.
L’école de demain
Encore une fois la numérisation de l’école doit se faire au pas de charge, sans réflexion ni recul critique. Et ce qui est supposé fonctionner pour les étudiants du supérieur pourra sans doute fonctionner pour les élèves du secondaire.
En vérité, avec le CNED, l’enseignement à distance existe depuis longtemps en France, sous une forme institutionnelle certes moins interactive et moins moderne mais en vérité plus personnalisée et plus approfondie (et par conséquent plus coûteuse pour la société) : ce service public est un mode d’enseignement dégradé, avec d’ailleurs des résultats mitigés, qui se substitue à l’école quand il n’y a pas d’autres choix et il faut beaucoup de motivation à l’élève ou à l’étudiant pour pouvoir en tirer profit. Cet enseignement à distance a du moins la vertu de préparer aux mêmes examens ou concours que les autres.
Tel est le paradoxe de la modernité : l’enseignement à visage humain serait désormais obsolète et ne pourrait rivaliser avec l’éducation claviérisée, moderne et en ligne, supposée plus démocratique et plus attractive, mais en réalité essentiellement plus économique. Ce n’est pas un hasard si les écoles de commerce – les premières – s’inquiètent de cette concurrence low-cost agressive.
En France, Geneviève Fioraso, la Ministre de l’Enseignement supérieur, prenant acte de notre retard, a récemment annoncé la création de « France Université numérique », ou « FUN » (sic), une cellule qui doit réinventer en quatre ans la pédagogie à l’heure d’Internet et mettre 20% des cours des universités en ligne d’ici la fin du quinquennat, emboîtant ainsi le pas des moocs dans la course à l’e-learning.
D’ores et déjà l’école n’est plus pensée comme une mission républicaine mais comme un marché ultra-concurrentiel en ligne.
De ce point de vue Coursera a déjà gagné son pari.