L'alternative à la « constante macabre », compatible avec l'ambition de l'école ?
Quand, dans la course effrénée à l'innovation pédagogique, l'évaluation positive par « contrat de confiance » s'oppose quelque peu au paradigme de l'enseignement et de l'évaluation par compétences.
L'alternative à la « constante macabre », compatible avec l'ambition de l'école ?
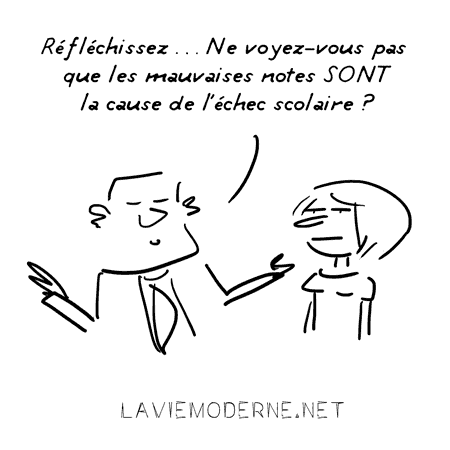
Si l'on consent à l'idée que “l'innovationisme”, en matière de pédagogie, est cette volonté qui vise à faire du neuf à tout prix le seul horizon conceptuel d'une démarche intellectuelle, où l'acte même d'innover est érigé comme l'unique substrat de ce “fonds de commerce” intellectuel, alors il serait difficile de ne pas y voir l'un des mécanismes d'une idolâtrie. Dès lors, le dogme de l'innovation apparaît comme l'objet même de ce nouveau culte.
Cette obsession monomaniaque (pardon du pléonasme, mais il entend délibérément forcer le trait) semble devenir une constante chez les thuriféraires des pratiques pédagogiques innovantes. Dans ce cénacle progressiste, « l'évaluation par contrat de confiance », est une trouvaille présentée par André Antibi comme alternative à ce qu'il nomme « la constante macabre ».
Ainsi, du seul fait qu'on a décidé de les frapper du sceau de la nouveauté − qu'importe si c'est fait de manière artificielle, les trouvailles pédagogiques sont religieusement élevées au pinacle. Mais, a-t-on au moins un semblant de souci de les interroger à l'aune de l'efficacité et au regard des objectifs institutionnels ? Pense-t-on, au passage, à leur compatibilité avec l'esprit et la vision des programmes et du projet éducatif en vigueur ? Telles sont les questions qui ont suscité la présente réflexion, qui tentera modestement de pointer du doigt quelques incohérences de cette nouvelle lubie de « l'évaluation par contrat de confiance » et surtout son incompatibilité avec le paradigme de la compétence.
De quoi s'agit-il ?
La question n'est pas nouvelle, étant donné que les observateurs du monde de l'éducation savent que le débat ouvert par cette pseudo innovation remonte à l'année 2003, date de parution de La Constante macabre (ou comment a-t-on découragé des générations d'élèves) (sic). Mais, la nouveauté réside dans le fait que le « Mouvement Contre la Constante Macabre » (MCLCM), association à but non lucratif initiée par l'auteur, bénéficie aujourd'hui du soutien institutionnel du Ministère de l'Éducation Nationale, toutes majorités confondues. Un soutien matérialisé par l'octroi d'une subvention en 2009, par une circulaire incitant à la mise en place d'un contrat de confiance dans la notation des élèves en 20111, par la présence d'un conseiller du ministre au colloque MCLCM de 20122 et par celle de la directrice générale de l'enseignement scolaire (DGESCO) en personne, Mme Florence Robine, au prochain colloque du 2 février 20173. Faut-il ajouter à cela les persistantes recommandations de certains inspecteurs de l'Éducation Nationale incitant vivement les enseignants à l'intégration des “préceptes” du mouvement dans leurs pratiques pédagogiques ?
Rappelons que, selon ce professeur de mathématiques à l'université Paul Sabatier de Toulouse, l'enseignant français, par souci de crédibilité, est, en général, enclin à distribuer le même pourcentage de mauvaises notes lors des évaluations, quel que soit l'objet de ces dernières. Comme il le dit lui-même dans son ouvrage :
« Par “constante macabre", j’entends qu’inconsciemment les enseignants s’arrangent toujours, sous la pression de la société, pour mettre un certain pourcentage de mauvaises notes. Ce pourcentage est la constante macabre. »
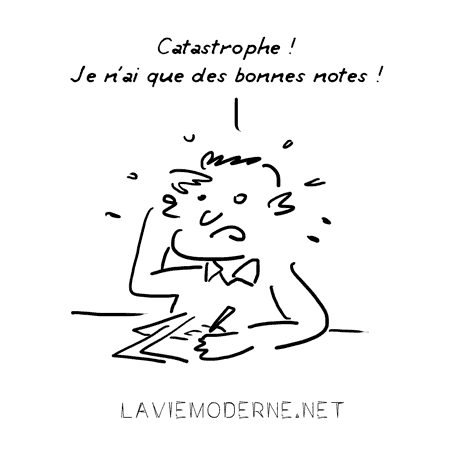
Plus qu'un oxymore, « s'arranger inconsciemment » devient vite un paradoxe qu'André Antibi propose de lever, en expliquant que les enseignants, pas si inconscients que cela in fine, ont une constante propension à évaluer leurs élèves sur la base de questions pièges et des problèmes inédits, voire des situations carrément non-étudiées en cours. La raison en est la sauvegarde de la sacro-sainte crédibilité de l'examen et de l'enseignant à l'égard de ses pairs et de la société. Il s'ensuit, selon lui, que les mauvaises notes, générées par cette conception de l'évaluation, reposent d'abord sur un contrat injuste et débouchent immanquablement sur une « constante macabre » (un sempiternel pourcentage de mauvaises notes) qui mettrait donc « en échec des élèves de façon artificielle ». Autant dire que les enseignants sont les premiers responsables de l'échec scolaire (ou du moins d'une partie de cet échec) et qu'ils sont les principaux pourvoyeurs de cette boîte de Pandore que leur conception de l'évaluation ouvre pour certains élèves, avec son inévitable cortège de conséquences néfastes : désengagement, sentiment d'échec, angoisse, perte de confiance, désespoir…
D'où la nécessité, toujours selon cet apôtre de “l'innovationisme”, de concevoir un nouveau système d'évaluation, « l'évaluation par contrat de confiance » (EPCC). Sans bousculer les habitudes d'enseignement, la méthode, réalisable à court terme et sans coûter le moindre sou, serait drapée de la vertu de redonner le goût d'apprendre aux élèves et, partant, d'améliorer sensiblement leurs performances. Admirons ensemble l'innovation révolutionnaire.
Pour lutter contre cette maudite « constante macabre », voici la recette préconisée :
1. Notifier aux élèves explicitement un programme de révision très détaillé, une semaine environ avant chaque contrôle, balayant toutes les notions déjà traitées et corrigées en classe, tout en les informant que les « 4/ 5 environ de l'épreuve du contrôle porteront » sur ces notions.
2. Mettre en place une séance de questions-réponses, « un ou deux jours environ avant l'épreuve, au cours de laquelle les élèves peuvent demander des explications ou des précisions sur certains points mal compris. »
3. Réserver 1/5 de l'épreuve d'évaluation à des questions ne figurant pas dans le programme de révision, mais qui ressemblent « à ce que l’élève a vu pendant la phase d’apprentissage, mais pas à l’identique comme pour les questions de la liste. »4
Un simulacre d'innovation et une fausse analyse
Applaudissons vigoureusement le coup de génie pour ce programme incroyablement novateur. André Antibi mériterait, à ce titre, les palmes académiques. Comme l'a relevé − non sans ironie − un enseignant dans sa contribution publiée au site « Sauver les lettres », André Antibi « vient d’inventer le fil à couper le beurre » avec ses préconisations. Comme si les enseignants n’avaient jamais songé à faire porter les contrôles sur les leçons apprises en cours.
C'est, au mieux, vivre dans un monde coupé de toute réalité ou, au pire, fabriquer une réalité fallacieuse, que de croire, ou faire accroire, que les enseignants, de par leur sadisme viscéral, négligeraient les aspects traités en classe pour focaliser l'essentiel de leurs contrôles sur des questions pièges. N'y a-t-il pas dans cette présentation arrangée de la réalité et dans ce simulacre d'innovation les effluves d'un certain sophisme ? Outre cet indigne faux procès, qui ne dit pas son nom, à l'endroit de l'enseignant, comment peut-on laisser croire que le fait d'indiquer aux élèves les notions à réviser avant un contrôle les rendrait plus travailleurs, aiguiserait leurs capacités cognitives et améliorerait, in fine, leurs performances ? La réussite scolaire serait-elle uniquement corrélée à une notification explicite des notions à réviser ? Les notions d'effort et de travail, le potentiel cognitif de l'élève, son environnement socio-culturel n'auraient aucune influence sur sa vie scolaire ?
Par ailleurs, comment ferait alors la lutte contre « la constante macabre » pour améliorer puis évaluer des compétences, comme l'exécution des tâches complexes, celles qui sortent du cadre du simple exercice d'application, comme la résolution de problèmes (surtout ceux mettant en jeu des tâches multiples nécessitant un traitement rigoureux des informations, en les hiérarchisant de manière ad hoc, l'effectuation de calculs intermédiaires et la conduite d'un raisonnement pertinent) ou la rédaction d'un texte structuré respectant tous les critères inhérents à sa typologie, eu égard à la difficulté de trouver à la fois les idées qui sont le matériau nécessaire à la rédaction, les exprimer dans un langage compréhensible, tout en tenant compte des contraintes stylistiques et langagières ? Faut-il rappeler que les difficultés relatives à l'exécution des tâches complexes sont d'abord liées à la nature de ces activités et à leur fondement didactique, et non à une quelconque constante macabre, et que la réussite dans l'exécution de ces tâches requiert − nolens volens − un potentiel intellectuel non négligeable ? Par quel miracle, diantre, l'évaluation par contrat de confiance fournirait-elle les aptitudes cognitives nécessaires pour aplanir toutes ces difficultés ?
L'EPCC compatible avec le paradigme de la compétence ?
Mais le pire est à venir. Même si l'on concède que le concepteur de « l'évaluation par contrat de confiance » pourrait se contenter d'inscrire sa trouvaille dans une logique de restitution des connaissances et des savoir-faire, le paradigme de la compétence n'en demeure pas moins la pierre angulaire des nouveaux programmes et du nouveau socle commun, en dépit d'une homélie institutionnelle plaidant en faveur d'un équilibre − plus supposé que réel du reste − entre “connaissance” et “compétence”.
Certes, en matière de pédagogie, la compétence n’est rien d’autre que la mise en perspective et la mobilisation, dans un seul continuum, d’un certain nombre de savoirs, aptitudes, attitudes pour réaliser une tâche, accomplir un projet, étudier une question, résoudre un problème et, partant, agir efficacement sur le réel cognitif. Mais, en considérant attentivement les programmes et le socle commun, on s'aperçoit que le paradigme de base y est bel et bien celui de “la compétence”. C’est à elle que revient le primat, puisque c’est en fonction de la compétence, érigée en matrice, que le choix des connaissances à mobiliser se détermine. C’est en quelque sorte “l'utérus” qui est amené à “couver” le profil d’employabilité attendu de l’élève, lorsqu’il arrivera sur le marché du travail. Dans cette perspective, la connaissance devient presque une sorte de “savoir jetable”, un simple “aliment scolaire” vite absorbé (dans le meilleur des cas) et vite rejeté par cet “embryon”, ce prolétaire post-moderne en formation qu'est l'élève du socle. Dans l’esprit des nouveaux programmes et du nouveau socle commun, qui font donc la part belle à l'approche par compétence, malgré le simulacre d’un équilibre, les connaissances ne sont plus un but en soi, mais un “outil” au service d’un “attendu”. Il n'y a qu'à voir ce sous-titre « Attendus de fin de cycle » qui revient comme une antienne dans chacune des différentes parties des programmes, pour achever de s'en convaincre.
Rappelons, à toutes fins utiles, la contribution de Bernard Rey, professeur titulaire de la chaire internationale des sciences de l’éducation à l'Université Libre de Bruxelles, quant à la détermination sémantique du concept de “compétence”. Il rappelle qu'il convient d'abord de distinguer entre « connaissances, procédures et compétences avec mobilisation » :
« Certaines compétences consistent à avoir enregistré un savoir, maîtrisé des connaissances, mais d’autres sont manifestement stéréotypées, automatisables (les tables d’opérations, utiliser le dictionnaire, mesurer une longueur, connaître les règles de premier secours). Je les appelle « des “procédures de base” plutôt que des compétences. Elles sont des “potentialités d’accomplir des tâches” que l’on peut, par entraînement, automatiser. Certaines compétences […] exigent de l’individu qui les maîtrise de se confronter à une situation nouvelle, dans laquelle il va devoir choisir une ou plusieurs procédures qui conviennent dans cette situation. »5
Par conséquent, il importe d'être vigilant à l'égard du galvaudage des mots, en veillant à éviter la confusion entre compétence réelle et procédure automatisable ou savoir-faire. La maîtrise des opérations de calcul, le traçage de figures géométriques ou la conversion de mesures… sont, par exemple, des procédures et non des compétences. La maîtrise d'une technique de calcul n'est pas une compétence, mais c'est le choix à bon escient de l'opération ad hoc pour résoudre un problème qui l'est ; de même que savoir conjuguer un verbe, c’est-à-dire connaître ses déclinaisons à toutes les personnes, est un savoir et un savoir-faire (connaître les terminaisons est un savoir, assigner une terminaison à un personne est un savoir-faire), alors que la véritable compétence c'est parvenir à réaliser à bon escient l'accord du verbe avec son sujet dans une phrase.
Il en résulte alors l'inévitable prise en compte d'un problème crucial : celui de la transférabilité. D'ailleurs, le propre d’une compétence authentique n’est-il pas d’être susceptible d’être transférée ou réinvestie dans des situations nouvelles, nécessairement différentes de la première situation, celle qui a servi de support à l'apprentissage ?6 À moins de naviguer à contre-courant du progressisme, en allant dans le sens de la logique de la transmission des savoirs et des savoir-faire, et d'oublier que l'enseignement ne consiste pas seulement à faire acquérir des connaissances et des procédures, ce qui équivaudrait à un renoncement à l'ambition ultime et affichée de l'école de rendre les élèves intellectuellement autonomes, comment alors « l'évaluation par contrat de confiance » entend-elle vérifier si l'élève est en mesure, ou non, de transférer ou de réinvestir une compétence ? C'est à André Antibi et aux laudateurs de sa trouvaille qu'incombe la gestion de cette aporie.
Poursuivons. Parmi les dix pièges dans lesquels tombent les enseignants, selon lui, pour ne pas échapper à la constante macabre, figure d'abord l'insertion dans les contrôles de « questions qui ne ressemblent pas à celles que l’élève a déjà traitées. » Il conviendrait à cet égard de l'interroger, par souci de rigueur de la pensée, s'il entend par « ne pas ressembler » que les questions posées mettent en jeu des notions qui n'ont jamais été traitées en classe, ou bien veut-il dire que ces questions, tout en concernant des notions déjà étudiées, se présentent sous des formulations nouvelles et/ou dans des situations inédites. On ose espérer que la première explication est à écarter, compte tenu de son invraisemblable contingence et de la mauvaise foi qui découlerait de son affirmation. Mais, si l'on se tient à la seconde hypothèse, faut-il lui rappeler que l'évaluation sérieuse d'une véritable compétence ne saurait faire l'économie de la vérification de son réinvestissement et de sa transférabilité, ce qui suppose nécessairement le passage par des situations inédites et complexes ? Or, c'est justement l'inhérence du principe de transférabilité à cette exigence qui fonde la notion de compétence, d'autant plus qu'il constitue l’objet d'une des attentes scolaires. C'est dans la situation inédite que l'opération de transfert prend tout son sens. Pour le dire plus prosaïquement, et au prix d'un truisme, pour qu'il y ait compétence, il faut que s'opère un transfert des connaissances et des procédures dans une situation nouvelle.
Considérons, pour illustrer le propos, l'exemple de la résolution de problèmes, dont André Antibi, tout professeur de mathématiques qu'il est, est bien placé pour en saisir l'épineuse problématique de l'évaluation. Si, lors d'un contrôle, on signifie aux élèves que le problème à résoudre met en jeu l'application du théorème de Pythagore, par exemple, c'est que l'on cherche à évaluer la procédure automatisée consistant en l'application de ce théorème ; alors que l'évaluation d'une véritable compétence s'abstiendrait de cette indication pour voir si les élèves trouveraient, par eux-mêmes, la procédure appropriée (dite experte) quant à la résolution du problème proposé. Il n'y a qu'à voir le cortège d'expressions qui émaillent les programmes (« avec pertinence », « à bon escient », « d’une manière adaptée », « raisonner », « justifier »...) pour nous rappeler qu'on a à faire à la notion de compétence et que c'est elle qui sous-tend l'idée même que l'ambition de l'école consiste à promouvoir l'autonomie intellectuelle des élèves.
N'en déplaise à notre André Antibi. Si pour lui la constante macabre fabrique artificiellement l'échec scolaire, il faudrait qu'il se résolve à admettre que c'est tout aussi de manière artificielle que son « évaluation par contrat de confiance », basée sur des questions qui ressemblent « à ce que l’élève a vu pendant la phase d’apprentissage », fabrique la réussite. Ne voit-il pas que la problématique de la compétence exacerbe une tension entre l'apprentissage automatisé et la capacité d'adaptation à la nouveauté ? Sous prétexte que le contrat didactique donne sa légitimité à l'évaluation de l'élève sur des procédures ou des connaissances (sur ce qui lui a été explicitement enseigné), doit-on pour autant faire fi de l'évaluation de la gestion de la situation inédite, matrice incontournable de la notion de compétence ?
Des interrogations
Eu égard à ce qui précède, il appert donc que « l'évaluation par contrat de confiance », étant loin de prétendre à une réelle évaluation des compétences, ne cadre finalement pas avec l'esprit des programmes et du socle commun, qui reposent justement sur la notion de compétence. Et, à ce titre, la trouvaille d'André Antibi ne peut que difficilement cohabiter avec cette grande ambition affichée de l'école qui veut doter les élèves d'un esprit critique et d'une autonomie intellectuelle.
Il en résulte que l'étonnement de la voir bénéficier d'un soutien institutionnel n'en est que plus grand. Comment l'institution peut-elle donc promouvoir ce qui est difficilement conciliable avec ses objectifs et son ambition ? Pourquoi veut-elle encourager un mécanisme d'évaluation qui disqualifie ouvertement une notion qui lui est chère : la compétence ? S'agit-il d'un brouillage sémantique savamment entretenu autour de ce concept, en évitant d'institutionnaliser une fois pour toutes son acception conventionnelle, admise par des chercheurs sérieux, de la trempe d'un Bernard Rey, pourtant souvent écouté des instances officielles, ou le culte de l'innovation est d'une puissance telle que l'engouement aveugle qu'il provoque pousse à accueillir le premier saltimbanque venu en deus ex machina, pourvu que sa trouvaille, même spécieusement estampillée “novatrice”, laisse poindre l'apparence de l'originalité dans le paysage des ordinaires ?
Cet antagonisme entre « l'évaluation par contrat de confiance » et les objectifs institutionnels serait-il le prix que l'institution aurait accepté de payer pour lui accorder son onction ? Il est vrai que, pour elle, le jeu en vaudrait la chandelle. Et pour cause : la trouvaille d'André Antibi fournirait un insigne subterfuge pour masquer l'échec scolaire. Alors, on n'est pas à une contradiction près ?
Si, d'ordinaire, l'on entend par échec scolaire l'échec dans les apprentissages, qu'est-ce qui empêcherait après tout de l'entendre également comme l'échec d'une politique éducative, d'autant plus que le premier peut, à certains égards, être corrélé au second ? Alors, tout ce qui peut cacher « cette misère que l'on ne saurait voir » est-il systématiquement le bienvenu ? N'allez donc pas chercher les origines de l'échec scolaire dans une politique éducative faite de méthodes pédagogiques douteuses, de l'hétérogénéité des élèves, situation générée par la suppression du redoublement et par le collège unique tel qu'il a été mis en place. Vous risquez d'être voué aux gémonies. Comment oseriez-vous jeter le discrédit sur une trouvaille, au prétexte qu'elle serait antinomique vis-à-vis de la grande ambition de l'école qui voudrait pourvoir les élèves d'un esprit critique et d'une autonomie intellectuelle, alors qu'elle permet d'atteindre un objectif double : masquer l'échec scolaire et passer sous les fourches caudines les enseignants en les rendant responsables de celui-ci ? Évertuez-vous à trouver quelque chose qui puisse masquer tout échec à l'école et vous voilà béatifié par la vulgate des progressistes, qui s'empressera de vous qualifier de phénix du monde de l'éducation !
La déclinaison institutionnelle de l'EPCC
Par ailleurs, un lecteur avisé a eu la perspicacité de penser aux griefs que l'on pourrait éventuellement opposer au présent réquisitoire à l'encontre des incohérences qu'occasionnerait une institutionnalisation de « l'évaluation par contrat de confiance ». Il en est ressorti, qu'ils reposeraient sur deux points : d'une part, les préconisations d'André Antibi ne se trouvent dans aucun texte officiel et, d'autre part, l'acception du mot “compétence”, retenue ici, ne saurait être recevable, eu égard au fait que la notion de “transfert” est précisément écartée, au regard de l'évolution qu'a connue le principe de l'EPCC. Cette pertinente remarque a conduit à un rapide examen de la situation, lequel a permis de relever ce qui suit.
Ainsi, il se trouve qu'un Bulletin officiel récent7 définit lui-même la notion de compétence comme « l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite. » Sauf à traiter les mots avec une désinvolture regrettable, faisant montre d'une certaine légèreté quant à la considération de leur véritable réalité sémantique et d'une absence de toute rigueur de la pensée, comment ferait-on pour tenir compte de cette définition officielle, tout en négligeant les considérations sémantiques qu'elle implique ? Au nom de quelle légitimité intellectuelle, doit-on écarter la notion de “transfert”, critère incontournable du concept de “compétence”, d'une définition qui reconnaît explicitement l'importance de la confrontation à la situation inédite ? Peut-il y avoir mobilisation des ressources pour faire face à une situation inédite, sans opérer un “transfert” des acquis ?
Comble de l'incompréhension, voici ce que reconnaît la Cellule Académique Recherche et Développement Innovation Expérimentation (CARDIE) de l'Académie de Créteil pour se prévaloir des retombées positives de son « Contrat Participatif d’Évaluation » (CPE) :
« En identifiant ces outils et en développant explicitement leur usage, les élèves deviennent capables de comprendre le contexte d’un savoir, de le « dé-contextualiser » et de le « re-contextualiser » pour opérer les transferts de compétences méthodologique et disciplinaires dont ils auront besoin. »8
Qu'est-ce à dire si ce n'est que les promoteurs du CPE reconnaissent sans ambages l'importance de la notion de transfert ? Seulement voilà, cette reconnaissance fait surgir un autre problème : on affirme, au préalable, que « l'évaluation doit servir à mesurer un niveau d'acquisition et non à « piéger des élèves » sous prétexte d'évaluer leur « capacité de transfert ». Mais, si l'on estime que la notion de “transfert” doit être écartée de toute évaluation, pourquoi continue-t-on de l'évoquer ? Il y a vraiment de quoi perdre son latin quant à la perplexité suscitée par la légèreté de ces affirmations antinomiques. Comment peut-on affirmer que la notion de “transfert” est écartée du CPE et en même temps prétendre l'avoir constatée comme résultat positif de l'expérimentation de ce même dispositif ? D'ailleurs, comment fait-on pour constater la capacité de « transfert de compétences » chez les élèves, sans l'avoir mesurée, c’est-à-dire sans lui avoir fait subir la sanction de l'évaluation ?
Des injonctions contradictoires
En résumé, la situation est la suivante : on reconnaît officiellement la notion de compétence, ce qui implique nécessairement la reconnaissance du principe de la “transférabilité” qui lui est inhérent. La grande ambition de l'école consistant à vouloir doter l'élève d'un esprit critique et d'une autonomie intellectuelle est proclamée, ce qui n'est au demeurant qu'un aboutissement logique de l'institutionnalisation de la notion de compétence. Et, en même temps, on s'escrime à faire cohabiter tout ça avec un dispositif d'évaluation qui fait ouvertement le deuil du principe de “transférabilité”.
Y-a-t-il un guide à l'horizon pour aider le pauvre enseignant à y voir un peu plus clair ?
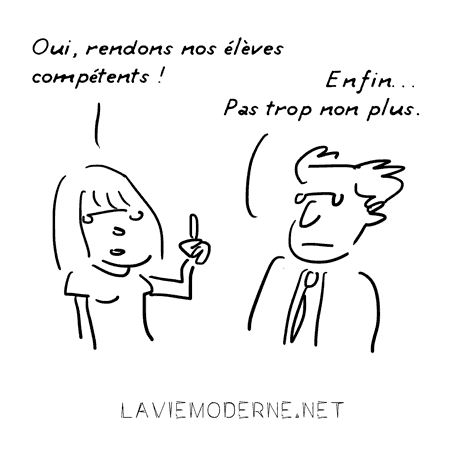
Faut-il alors enseigner selon une approche par compétence et s'en affranchir au moment de l'évaluation ? La perplexité de l'enseignant n'en est que plus grande. Car, quel sens alors donner à cette logique curriculaire, ce nouveau “mantra” dont on aime se gargariser urbi et orbi, et qui entend non seulement définir les contenus disciplinaires à enseigner, mais également leur mode d’enseignement et leur modalité d'évaluation ; le tout dans une volonté manifeste d'articuler, dans un même continuum, les programmes avec le socle ?
Eu égard à toutes ces considérations, et sans évoquer à nouveau le caractère inapproprié de ces dispositifs pour évaluer des compétences comme la dissertation ou la véritable résolution de problèmes, il faudrait que les thuriféraires de l'EPCC ou de sa version remaniée (« le Contrat Participatif d’Evaluation »), nous expliquent comment se sortir de ces différentes apories.
Que dire enfin ? Diantre ! Ce qui est nouveau est-il nécessairement bon ? Y a-t-il une loi naturelle qui stipule que le neuf et le moderne, en matière de pédagogie en l'occurrence, sont intrinsèquement féconds et fondamentalement exempts de toute ineptie ? On aimerait le croire. Mais en attendant, c'est surtout à un constat qu'il convient de se résoudre : avec l'innovation, qui se suffit à elle-même comme objet de son propre culte, des “chapelles” chargées de relayer ses “vertus”, des “apôtres”, prenant le contre-pied, nonobstant tout bon sens, des enseignements d'une Hannah Arendt, selon lesquels l'école, étant chargée de transmettre un patrimoine scientifique et culturel, comporte nécessairement une dimension de “conservatisme”, on peut dire que la complétude cultuelle du progressisme pédagogique est parachevée. Opposer la moindre objection à son idolâtrie de la nouveauté, pourvu qu'elle soit paisible et “non intégriste”, serait un relent de partisanerie fort mesquin, qu'on ne peut que récuser. Mais, de grâce, qu'on reconnaisse enfin aux enseignants leur aspiration à une quête de la cohérence, cette ultime norme nécessaire à un exercice serein de leur métier ! Vive la liberté !
Mohamed
Notes
[1] Ministère de l'Éducation nationale, circulaire du 2 mai 2011 : "Préparation de la rentrée 2011".
« La qualité et la pertinence de l'évaluation, comme levier de réussite des élèves, doivent être l'objet d'un travail de réflexion collective permanent au sein des écoles et des établissements. L'enseignant veillera particulièrement à ce que les « contrôles » soient annoncés aux élèves et que les points sur lesquels ils porteront aient été travaillés préalablement et soient clairement répertoriés. Il pourra également préciser aux élèves quels items de quelle(s) compétence(s) sont visés par chaque évaluation. »
[2] « EducPros » du 21 juin 2012 : « Evaluation des élèves : la constante macabre reconnue par le ministre de l’Education ».
[3] « Café pédagogique » du 22 décembre 2016 : « Constante macabre : Colloque le 2 février ».
[4] Contribution d'André Antibi sur le site du Ministère à l'occasion de la Conférence nationale sur l’évaluation des élèves (novembre 2014).
[5] « Café pédagogique » du 15 mai 2009 : « Bernard Rey : Les compétences, oui, mais ce qui compte, c'est de faire apprendre… »
[6] Ce n'est que par abus de langage que les nouveaux programmes désignent comme “compétences” les savoir-faire qui apparaissent sous la dénomination « Connaissances et compétences associées ». Les véritables compétences sont à chercher sous l'intitulé « Attendus de fin de cycle » et dans le Socle Commun.
[7] Bulletin officiel n°17 du 23 avril 2015, relatif au socle commun.
[8] CARDIE de Créteil, « Le contrat participatif d'évaluation : une évaluation sans piège ».
- Écrit par : Loys
- Clics : 12296